Désolé, cet article est seulement disponible en English.
Aug 05 2016
médias chrétiens au Moyen-Orient: une introduction
Désolé, cet article est seulement disponible en English.
Oct 15 2015
Théologie palestinienne contextuelle : essai de bibliographie classifiée depuis l’an 2000
Théologie palestinienne contextuelle: essai de bibliogrpahie cassifiée depuis l’an 2000
Contenu
Contexte socio-culturel et politique
Centres de réflexion théologique
Le centre Sabeel (centre œcuménique de théologie de libération)
Dar An-Nadwa (Forum international de Bethléem)
Thèmes de la théologie contextuelle palestinienne
Justice, paix, pardon, réconciliation et autres
Le dialogue à ses différents niveaux
-
Introduction
Dans une étude précédente, nous avons essayé de présenter une première ébauche de synthèse de la théologie palestinienne contextuelle1, couvrant plus ou moins le trajet de cette théologie depuis son début dans les années 80 jusqu’à l’aube de l’an 2000. Depuis lors, cette théologie a poursuivi son chemin, ce qui requiert d’explorer ses nouveaux développements. Il faut dire que ce n’est pas un travail facile, étant donné la difficulté de définir les frontières et les contours de cette théologie (il est peut-être trop tôt de le faire). Toutefois, et malgré toutes les difficultés, ce travail est à faire. C’est ce que nous essayons dans cette étude.
Dans notre étude précédente, la méthode suivie a été celle de présenter les principaux protagonistes de cette théologie et leurs contributions. Dans la présente, nous nous arrêtons plutôt aux thèmes de cette théologie et, dans le cadre de ces thèmes, la contribution de chacun des protagonistes est mentionnée.
Nous rappelons que la terminologie employée pour donner un nom à cette théologie est assez diverse : Théologie de libération (le centre Sabeel), théologie contextuelle (le Forum International de Bethléem), théologie locale ou incarnée (le centre Al-Liqa). Mais il faut dire que ces divers noms sont englobés dans celui de théologie contextuelle palestinienne, que nous employons ici.
Dans une première partie, nous essayons de présenter brièvement le contexte général de cette réflexion théologique à partir de l’an 2000, à savoir la situation surtout politique de nos sociétés en Terre Sainte, mais aussi au Moyen-Orient, qui a eu un impact profond sur cette réflexion. Dans une seconde partie, nous nous arrêtons sur le milieu de vie de cette réflexion théologique, à savoir les divers centres dans lesquels elle s’est développée. Enfin, dans une troisième partie, la plus importante et la plus longue, nous nous arrêtons aux divers thèmes de cette théologie.
Il est évident que nous ne pouvons entrer dans les détails de cette théologie pour en présenter les thèses. Notre étude est plutôt un essai de bibliographie – la plus complète possible et située dans son contexte – que nous mettons au service des chercheurs qui voudraient aller plus loin et plus profondément dans l’étude de cette théologie et ses thèses sur chacun des thèmes mentionnés ici2.
La période que nous couvrons dans cette étude, à savoir les quinze premières années du troisième millénaire, est l’une des plus difficiles et même des plus dramatiques que la région (Palestine et monde arabe) ait connue dans son histoire moderne. Après les attentes et les espoirs qui ont germé dans les cœurs à l’approche du troisième millénaire, les événements qui ont marqué cette période ont jeté nos pays et nos sociétés dans l’inconnu, avec tout ce que cela comporte de peur, de frustration et d’angoisse, aggravant ainsi leur instabilité traditionnelle. Toutes les couches de nos sociétés ont été affectées d’une manière tragique par l’évolution rapide des événements. Les chrétiens, de leur part, se sont trouvés dans la tourmente et en ont souffert aussi, en tant que chrétiens et en tant que citoyens.
Si nous voulons décrire la situation de nos pays et de nos sociétés au moment présent, nous pouvons la résumer schématiquement en deux mots : L’instabilité de nos sociétés et les interventions étrangères.
Depuis leur retour sur la scène de l’histoire moderne dans la deuxième partie du XIXème S., les pays arabes et leurs sociétés ont vécu dans l’instabilité à tous les niveaux, politique, culturel, social et économique. Tiraillées et ballottées entre tradition et modernité, entre développement et pauvreté, entre éducation et analphabétisme, entre régimes dictatoriaux et démocratie, entre État moderne et corruption, ces sociétés ont fait des expériences variées (dont les plus importantes sont de type nationaliste, socialiste et islamiste), qui toutes se sont soldées par un échec. Cette instabilité fait que nos sociétés restent fragiles, facilement manipulables et exaspérées.
C’est dans ce cadre que survinrent ce qu’on a appelé « le printemps arabe » ou « les révolutions arabes » à partir de 2011. Ici, une brève explication s’impose. Il est certain que la plupart des pays arabes étaient gouvernés par des régimes corrompus, dictatoriaux et oppressifs, qui ont laissé leurs populations démunies de leurs droits les plus élémentaires. Très souvent, ces régimes étaient protégés par les puissances occidentales, qui voyaient en eux les garants de leurs intérêts et de leurs stratégies. Une telle situation ne pouvait s’éterniser. A la surprise générale, et contre toute attente, les populations arabes se sont insurgées d’une manière sans précédent pour aboutir à des changements dramatiques, à commencer par la Tunisie et l’Égypte. Dans tous les pays de la région, et dans les différentes couches de la société, ces soulèvements ont suscité un enthousiasme immense. En effet, partout les populations ont eu à souffrir de ces régimes, au point de vue politique, économique et social. Elles ne pouvaient par conséquent que réagir avec beaucoup d’espérance et d’attentes. Les chrétiens eux-mêmes ont pris part active à ces soulèvements, surtout en Égypte3.
Mais très vite, les événements ont commencé à prendre une tournure différente, qui n’était pas dans l’intérêt de la population. La Tunisie et l’Égypte elles-mêmes ont eu le temps d’en prendre conscience et ont fait une révolution dans la révolution pour redresser la situation, sans arriver encore à la stabilité souhaitée. C’est à ce moment que l’enthousiasme et l’espérance ont cédé la place à la déception, à l’amertume et même au désespoir. C’est là que se situe un autre facteur qui a déterminé le cours des événements dans la région, à savoir les interventions étrangères dans les affaires des pays concernés.
Il va sans dire que notre région ne laisse personne indifférent, pour sa position stratégique et son importance politique, économique (gaz et pétrole) et religieuse. Les grandes puissances y ont des intérêts immenses, qui les poussent à intervenir pour les protéger. Il faut dire que ces interventions remontent loin, mais elles sont devenues plus fréquentes et plus décisives surtout vers la fin du XIXème S., lors du déclin de l’Empire Ottoman. Depuis la fin de la première Guerre mondiale surtout, elles ont pris des formes concrètes et directes, quand elles ont divisé la région en de petits États, souvent d’une manière arbitraire et artificielle. La fondation de l’État d’Israël au cœur de ce monde en est une illustration éloquente.
Pour la période qui nous concerne (à partir de l’an 2000), ces interventions sont devenues de plus en plus fréquentes, semant la destruction et la mort. Il faut dire que le nouveau millénaire a débuté par un cataclysme : les attentats terroristes de New York et de Washington, le 11 septembre 2001. Depuis lors a commencé la « guerre contre le terrorisme », avec ses conséquences désastreuses pour la région. C’est ainsi que la guerre en Afghanistan a commencé à partir d’octobre 2001. Deux ans plus tard, ce fût le tour de l’Irak en mars 2003, avec l’invasion de ce pays. Cette guerre a été désastreuse pour l’Irak, puisqu’elle a entraîné des centaines de milliers de victimes et pratiquement la destruction de ce pays. Les chrétiens d’Irak en ont eux aussi subi les conséquences tragiques, puisque la majorité de cette chrétienté s’est vue la cible d’attaques terroristes, entraînant leur dispersion aux quatre vents, sous le regard indifférent des forces d’occupation. En conséquence à tout cela, les groupes islamistes terroristes se sont implantés dans ce pays et dans d’autres parties du monde arabe, semant la mort et la destruction dans toutes les couches de la population, frappant les chrétiens d’une manière particulière, mettant toute la région dans un état d’incertitude et de chaos.
Pour ce qui est des « révolutions » arabes, les grandes puissances n’ont pas tardé à intervenir d’une manière ou d’une autre pour orienter ces soulèvements dans le sens de leurs intérêts propres, politiques et économiques, sous la couverture de la démocratie et des droits de l’homme. Elles étaient épaulées en cela par de petites puissances régionales (Arabie Saoudite, Qatar et Turquie, sans oublier, d’une manière indirecte, Israël), toutes alliées de l’Occident. L’intervention la plus directe s’est effectuée en Libye, lorsque les insurgés de ce pays ont fait appel à l’Otan, qui est intervenu avec toute sa force, pour laisser le pays par la suite dans le désordre le plus total. En Syrie, de suite après les premiers soulèvements, la révolution a été armée avec l’aide surtout de l’Arabie Saoudite, de Qatar et de la Turquie. On s’était rendu compte bien vite que le but n’avait rien à faire avec la démocratie et les droits de l’homme, mais était tout simplement la destruction de l’État syrien, à l’exemple de l’Irak. Et le plus comique dans le cas de la Syrie c’est que les soi-disant champions de la démocratie (Arabie Saoudite et Qatar) sont les pays les plus autocratiques et les plus oppressifs dans le monde. C’est ainsi que le « printemps » arabe est devenu un « hiver » arabe, mettant le chaos dans les parties les plus importantes du Moyen-Orient (Irak, Syrie, et aussi l’Égypte).
Dans ce chaos général, les courants islamistes extrémistes se sont développés et ont réussi à s’implanter dans diverses parties du monde arabe. Il serait bon de rappeler que ces courants extrémistes sont nés surtout en Arabie Saoudite avec l’idéologie intégriste Wahhabite, qui s’est propagée ensuite dans le monde arabe sous le nom des Frères Musulmans. Ces extrémistes ont combattu en Afghanistan contre l’Union Soviétique d’alors, aidés en cela par l’Occident. Nous connaissons ensuite les avatars de ces courants (Al-Qaïda, Taliban, ISIS, Nousra et une multitude d’autres fractions de ce genre), de plus en plus extrémistes et sanglants. Dans les révolutions arabes, les courants islamistes (Frères Musulmans et Salafistes surtout), fortement organisés, ont réussi, profitant de ce vide, à s’emparer du pouvoir et à mettre en place des régimes islamistes avec, semble-t-il, la complicité secrète des grandes puissances qui voyaient en eux des alliés possibles et sûrs. Mais tout cela n’allait pas dans le sens des masses populaires, qui ne voyaient pas dans cette évolution la réalisation de leurs aspirations. En Tunisie et en Égypte, le vent a tourné contre ces régimes, pour arriver à la situation actuelle dans ces pays, dont le terrorisme constitue le danger principal. C’est dans ce climat d’incertitude et d’instabilité que vit actuellement le monde arabe, climat qui traîne à sa suite des milliers de victimes innocentes.
En Palestine, la situation est différente, l’occupation israélienne étant le problème fondamental des Palestiniens. Ces soulèvements populaires ne les laissent pas indifférents, mais leur priorité est ailleurs, à savoir la lutte contre l’occupation israélienne. Tous leurs efforts vont dans ce sens.
Nous savons qu’un début de processus de paix a été entamé dans la conférence internationale de Madrid (1993). Suite à cette conférence, des pourparlers de paix ont commencé entre l’OLP (Organisation de la Libération de la Palestine) et l’État d’Israël. Or ces négociations n’ont jamais abouti à quelque résultat concret. Pendant vingt ans, elles n’ont fait que tourner en rond et on a l’impression que leur but consiste à gérer le conflit plutôt qu’à le résoudre. De plus, depuis le début du processus de paix, la situation des Palestiniens n’a cessé de se détériorer à tous les niveaux, politique (un processus de paix sans issue), économique (le bouclage des territoires, la dépendance de l’économie palestinienne de celle de l’État d’Israël, le chômage…), social (le mur de séparation qui a disloqué les territoires palestiniens, faisant d’eux des cantons sans vraie communication entre eux). Si la solution prévue est celle de deux États, palestinien et israélien, cette solution est rendue impossible par la construction à haute vitesse des colonies juives dans les territoires palestiniens, sans parler de la fermeture de la ville de Jérusalem, coupant les Palestiniens de leur centre vital. Entre-temps, trois guerres sanglantes ont été menées contre Gaza sans aboutir à la moindre solution, sinon à détruire et à semer la mort. Bref, nous sommes dans l’impasse. Dans cette atmosphère générale, on remarque parmi les Palestiniens un mouvement vers la résistance non-violente, qui prend de plus en plus d’envergure et qui est très active ici ou là dans les territoires contrôlés par Israël.
Si je me suis attardé à ce contexte, c’est qu’il a eu un impact profond sur la réflexion théologique des chrétiens palestiniens. En effet, une théologie contextuelle doit nécessairement prendre en considération ce contexte, qui, en fait, a ouvert le chemin à de nouveaux problèmes et à une très grande diversité de sujets et d’approches. C’est dans ce cadre que nous allons explorer les orientations de la théologie contextuelle palestinienne, en nous arrêtant d’abord aux divers centres qui ont pris en charge cette théologie, pour ensuite passer aux grands thèmes de cette théologie.
À partir des années 80 du siècle dernier, des centres d’initiative chrétienne ont été fondés successivement en Palestine. Depuis l’an 2000, l’activité de ces centres s’est intensifiée, tant par leur production que par les conférences, locales et internationales, qu’ils organisent assez régulièrement. La théologie contextuelle palestinienne est inséparable de ces centres qui l’ont prise en charge et en sont le milieu vital. En effet, c’est dans ces centres surtout – mais pas exclusivement – que la théologie palestinienne s’est développée et c’est à travers ces centres que ses protagonistes les plus importants ont continué leur réflexion théologique. Jetons-y un regard global et rapide.
Le premier en date de ces centres est celui d’Al-Liqa. Fondé en 1982 par un jeune universitaire palestinien, le Dr. Geries Khoury, avec la collaboration de collègues chrétiens et musulmans, il s’était fixé des objectifs bien précis: promouvoir et approfondir les relations islamo-chrétiennes en Palestine, sous le nom Center for Religious and Heritage Studies in the Holy Land. Depuis lors, il est resté fidèle à cette option. Bien vite, les membres chrétiens de ce centre ont senti le besoin d’approfondir parallèlement leurs engagements chrétiens à partir de leur foi. Pour répondre à ce besoin, la branche Théologie et Église Locale a été fondée et a commencé son activité en publiant un document portant le même titre4. C’est cette branche surtout qui a pris en charge le souci de développer une théologie locale à partir de la situation concrète du peuple palestinien et de la communauté chrétienne locale, en d’autres termes une théologie palestinienne contextuelle.
Pour atteindre ce double objectif, le moyen privilégié a été celui d’organiser des conférences annuelles pour les deux branches (en tout 25 conférences pour le premier programme et 22 pour le second). Les actes de ces conférences étaient régulièrement publiés dans des livres à part ou dans la revue Al-Liqa.
L’initiative la plus heureuse de ce centre a justement été la publication, en 1985, d’une revue sous ce nom d’Al-Liqa, en arabe, à raison de quatre numéros par an, comme aussi d’une revue semestrielle en anglais, dont les articles sont surtout des traductions de l’arabe. La revue est à sa trentième année, chose rare en Palestine et dans le monde arabe. Non seulement, elle a continué à paraître, mais elle s’est développée avec le temps, jusqu’à devenir une référence obligée de la théologie palestinienne contextuelle. C’est à juste titre qu’elle a été qualifiée de bibliothèque. À l’occasion de son dixième anniversaire, elle a publié un index détaillé de son contenu et pour ses 25 ans (2010), elle a publié un autre index couvrant toutes les années de son existence5.
En plus de cette revue et des autres initiatives, le centre a eu aussi une activité éditoriale régulière importante, ayant à son actif plus d’une vingtaine de titres dans tous les domaines de son intérêt.
Depuis l’an 2000, les conférences annuelles ont suivi la courbe des événements dans la société et dans l’Église, non seulement en Palestine, mais aussi dans le monde arabe. Dans le reste de cet article, nous essaierons en son lieu de rendre compte de la contribution de cette activité à la théologie contextuelle6.
Le centre Sabeel, fondé en 1989 par le pasteur anglican Naim Ateek, se veut « un centre œcuménique avec une approche théologique et non-violente du conflit israélo-palestinien ». Le pasteur Ateek lui assigne trois objectifs principaux: 1) Développer une théologie de libération, qui affronte l’idéologie sioniste, surtout dans son expression religieuse, soutenue par ce qu’on appelle le « sionisme chrétien », basé sur la domination et l’oppression; 2) « La libération de la théologie », des abus des interprétations bibliques politiques et idéologiques, pour considérer la Bible comme « une histoire d’un Dieu aimant, juste et inclusif »; 3) Travailler pour « la justice et la paix », tout en rappelant que ces trois dimensions sont inséparables7.
Ces objectifs, Sabeel essaie de les atteindre surtout à travers des conférences internationales, auxquelles sont invitées des personnes qui viennent des diverses parties du monde, surtout des régions qui connaissent des situations politiques similaires à celles de la Palestine. Les actes de ces conférences sont publiés, surtout en anglais. En plus de cette activité, le centre Sabeel est aussi actif sur le terrain et organise des activités de caractère œcuménique, surtout avec le clergé des diverses Églises de la Terre Sainte. Il lance aussi des initiatives de lutte non-violente (contre le mur de séparation et autres), et prend part aux activités programmés par d’autres groupes.
Son activité éditoriale consiste surtout à publier les actes des conférences internationales, comme aussi des livres qui traitent de problèmes toujours liés à la théologie de libération. Le centre édite une publication en anglais (Cornerstone) qui publie de petits articles sur les divers thèmes qui concernent la théologie contextuelle palestinienne.
Ce centre a été fondé à Bethléem par le pasteur luthérien Mitri Raheb. Au cours des années, son activité a couvert plusieurs domaines: folklore, arts, cinéma, théâtre, etc., qui offrent un forum de dialogue entre foi et culture. Le centre comprend un grand ensemble avec beaucoup de facilités pour des activités très diverses. Mais sa préoccupation principale est celle de développer une théologie contextuelle. A cette fin, il a organisé plusieurs congrès internationaux autour de thèmes de caractère théologique à partir de la situation en Terre Sainte.
En 2011, il a fondé une maison d’édition sous le nom de Diyar Publisher, qui publie, en plus des actes de ses diverses conférences internationales, des livres d’intérêt divers (histoire, religion, chrétiens palestiniens…), en arabe et en d’autres langues.
L’Université de Bethléem a été fondée par le Vatican en 1973 et confiée aux Frères de Écoles Chrétiennes. En 1987, elle a intégré le centre Saint Cyrille pour la formation des adultes et la préparation de catéchistes, pour en faire un programme universitaire sous le nom « Département des Études Religieuses », où il octroie un BA en sciences religieuses. L’importance de ce département vient du fait qu’il constitue une infrastructure pour la théologie contextuelle, dans ce sens qu’il prépare un public formé qui est capable de suivre et de comprendre les études de théologie contextuelle. Mais son activité ne s’est pas arrêtée là. Depuis que le P. Jamal Khader en a pris la responsabilité (et plus tard aussi en tant que doyen de la faculté des Lettres), ce département a commencé à organiser des congrès locaux et internationaux (4 jusqu’à maintenant), ayant pour sujets des thèmes qui intéressent de près la théologie contextuelle (relations islamo-chrétiennes, religion et État, le vivre ensemble, religion et violence…). Les actes de ces congrès ont été publiés régulièrement par l’université.
Il faut aussi mentionner le Collège biblique de Bethléem (Bethlehem Bible College). De tendance plutôt néo-évangélique, cette institution a rejoint le souci d’une théologie contextuelle à sa manière, dans le cadre d’une interprétation plutôt fondamentaliste de la Bible. Mais, à l’opposé de l’interprétation évangéliste sioniste, il essaie de développer une interprétation qui prend en considération le problème palestinien. Son curriculum inclut un cours sur la théologie contextuelle palestinienne et certains de ses professeurs sont actifs dans ce sens (Hanna Katanasho, Salim Munayer et autres), sur le plan local et international.
Il est à remarquer que les écrits de la théologie contextuelle dépassent les limites de ces centres. En effet, plusieurs de ses protagonistes, tout en collaborant avec ces centres, ont une activité éditoriale en dehors de ses limites: Michel Sabbah, Elias Chacour, Mounib Younan, Viola Raheb et autres.
Dans ce cadre aussi, il faut mentionner la revue Proche-Orient Chrétien, revue semestrielle fondée par les Pères Blancs de Jérusalem en 1951. Elle est spécialisée dans les recherches concernant les Églises orientales (études et informations). Même si elle n’est pas directement impliquée dans le mouvement de la théologie contextuelle palestinienne, elle publie souvent des articles qui intéressent cette théologie en Palestine et au Moyen-Orient, par des auteurs de la Terre Sainte et du Moyen-Orient. Il suffit de parcourir ses index annuels pour s’en rendre compte8. Pour ce qui est de l’œcuménisme en Terre Sainte et dans tout le Moyen-Orient dans toutes ses dimensions, elle est une référence incontournable.
Il est certain que nous nous trouvons en face d’une littérature assez large. Il n’est pas possible de rendre compte de tout et de tous. Nous nous contentons des grands thèmes de cette théologie contextuelle et la contribution de ses protagonistes les plus importants9. Il est à remarquer aussi que beaucoup d’étrangers ont contribué à cette théologie, surtout lors des congrès internationaux, mais nous nous limitons ici aux contributions locales, à savoir les théologiens palestiniens, tout en y incluant aussi les étrangers qui sont implantés dans le pays et qui travaillent dans le cadre de ses Églises. Il est à remarquer, finalement, que nous ne pouvons pas entrer dans les détails de cette théologie, surtout qu’elle est assez diversifiée. Nous nous arrêtons à ses grands thèmes, laissant aux spécialistes de les approfondir.
Dans les milieux du centre Al-Liqa, nous remarquons ces dernières années une conscience de plus en plus marquée de la nécessité d’approfondir la foi des chrétiens palestiniens pour qu’elle soit à la hauteur des défis actuels. En effet, une foi superficielle ou sociologique ne peut aboutir qu’à un modèle ecclésial superficiel et sociologique et à une présence déterminée par des facteurs sociaux plutôt que par une vision de foi. Dans ce cadre, il importe de rappeler la grande initiative des Ordinaires Catholiques de Terre Sainte, à savoir le Synode diocésain des Églises catholiques de Terre Sainte (1992-2000), dont une des premières étapes a été de lancer une large campagne d’évangélisation (1995-1997), ayant pour but le renouveau de la foi. Cette campagne a atteint des couches assez larges de la communauté chrétienne et a été une occasion pour beaucoup de fidèles de revenir aux sources vives de leur foi10. Le grand résultat de cette initiative a été la promulgation, après sa discussion dans l’Assemblée Générale de ce synode (8-12 février 2000) d’un plan pastoral des Églises catholiques de Terre Sainte qui reste un instrument précieux pour cette évangélisation à l’avenir et dont la dimension théologique est évidente11.
Le centre Al-Liqa, pour sa part, a organisé sa XXVIème conférence (2011) sur le sujet12, autour de quatre axes: La foi (R. Khoury13, M. Sabbah14), l’Église (J. Khader15, P. Sayyah16), la présence chrétienne dans la société (G. Khoury17) et l’autre (I. Mouallem18, G. Khoury19), tout cela à partir du contexte de la Terre Sainte. Cette conférence représente un début de réflexion sur cette thématique.
Dans un article, où il énumère les divers défis qu’affrontent des chrétiens d’Orient, R. Khoury met en premier lieu les défis concernant la foi, affirmant la nécessité de renouveler la foi si nous voulons assurer une présence chrétienne dans l’Orient arabe basée sur notre identité chrétienne20. Il poursuit sa recherche dans deux directions, le passé et l’avenir. Pour ce qui est du passé, il jette un regard critique sur la présence chrétienne en Orient, surtout au XIXème S., pour dire que cette présence s’est inspirée surtout de facteurs idéologiques en dehors de la foi chrétienne, sinon contraires à la foi21. Pour ce qui est de l’avenir, il présente une étude sur la nouvelle évangélisation dans le cadre des Églises d’Orient dans le monde arabe, développant sa vision d’une nouvelle évangélisation qui part de la situation concrète des pays arabes22. Il est évident que la foi dont il est question ici n’est pas une foi abstraite et atemporelle, mais incarnée et inculturée dans son milieu humain et culturelle23.
Le renouveau de la foi ne peut être séparé de celui de l’Église ou des Églises en Orient; il est à entreprendre à plusieurs niveaux: l’identité de nos Églises24, le modèle ecclésial et l’œcuménisme (dont il sera question ultérieurement). Or nous savons que ce modèle est traditionnellement commandé par la mentalité confessionnelle (Al-Taifieh, en arabe), très répandue en Orient. Le renouveau de la foi consiste à dépasser ce modèle pour une Église basée sur une vision de foi sur le mystère de l’Église25.
Nous savons que point de départ de la théologie contextuelle palestinienne a été l’interprétation biblique. En effet, plusieurs clercs, des diverses Églises de Terre Sainte, ont étudié en Occident. Et là, ils ont été choqués par les diverses interprétations biblique qui justifiaient, d’une manière ou d’une autre, l’injustice dont eux-mêmes, leur famille et leur peuple ont été les victimes. De retour chez eux, ils sont passés du scandale et du désarroi à la réflexion et ils ont commencé à étudier les divers aspects de cette interprétation et ses retombées désastreuses sur leur peuple26.
Depuis lors, cette réflexion s’est poursuivie dans les divers milieux de la théologie contextuelle. Il faut remarquer que cette théologie a pour cible surtout l’interprétation biblique fondamentaliste des milieux évangéliques, qui s’est développée depuis longtemps surtout en Grande Bretagne et aux États-Unis et qui est connu aujourd’hui sous le nom de Sionisme chrétien. Ces tendances fondamentalistes sont actives à Jérusalem de la manière la plus arrogante et triomphaliste avec ce qu’on appelle « L’ambassade chrétienne à Jérusalem », dont les activités provocatrices (appui aveugle et inconditionné à la politique extrémiste des gouvernements israéliens, en ce qui concerne l’oppression, la construction illégale des colonies, la judaïsation de la Ville Sainte…) scandalisent les Palestiniens (chrétiens et musulmans) et leur posent bien des questions.
Dans cette atmosphère, le centre Sabeel a organisé plusieurs congrès internationaux sur ce sujet, dont les titres sont suggestifs: « Challenging Christian Zionism. Theology, Politics and the Israel-Palestine Conflict » (5èmeConférence)27, « Challenging Empire. God, Faithfulness and Resistance » (8ème conférence)28, « The Bible and the Palestine-Israel Conflict » (9ème conférence)29.
En plus de ces congrès, et toujours dans les milieux du centre Sabeel, il faut mentionner le livre de Naim Ateek sur la réconciliation30. Nous reviendrons à ce livre. Ici, nous nous contentons d’attirer l’attention sur l’interprétation biblique qui y est développée. En effet, la deuxième partie de ce livre traite longuement de ce sujet31. En plus d’un chapitre sur la Bible et la terre32 et un autre sur les chrétiens sionistes33, l’auteur développe plusieurs lectures bibliques intéressantes autour de quelques grandes figures de l’Ancien Testament à la lumière de la situation en Palestine et dans le monde: Jonas34, le Serviteur souffrant35, Samson36, Daniel37, pour finir par une vision biblique sur Jérusalem38.
Le Forum International de Bethléem (Dar An-Nadwa), pour sa part, s’intéresse d’une manière assidue à l’interprétation biblique et a lui aussi organisé plusieurs congrès internationaux sur ce sujet, dont les plus importants ont traité de ce que le centre appelle « herméneutique de libération ». Le premier a porté le titre « The Invention of History » (5ème conférence, 2009)39 et le second « Biblical Texts, Ur-contexts, and Contemporary Realities » (6ème conférence, 2011)40.
En plus de ces congrès, Mitri Raheb a publié un livre qui traite de l’interprétation de la Bible dans le contexte palestinien où nous trouvons plusieurs approches de la Bible dans une perspective palestinienne (le peuple palestinien, Dieu, Jésus, l’Esprit)41.
En plus de ces contributions majeures de Sabeel et du Forum International de Bethléem, le centre Al-Liqa s’est intéressé, quoique sporadiquement, à ce sujet de l’interprétation biblique. Dans ce cadre, nous mentionnons la contribution de Rafiq Khoury dans un certain nombre d’articles. Dans un premier article, il présente d’abord un regard général sur l’interprétation biblique, où il mentionne brièvement l’interprétation fondamentaliste et la perspective palestinienne de cette interprétation42. Dans un second, il applique ce regard à la situation en Palestine et entreprend aussi une critique des interprétations sionistes de la Bible43. Dans un troisième, il présente la perspective selon laquelle le peuple palestinien est un « lieu théologique », dans ce sens que l’interprétation de la Bible doit nécessairement prendre en considération la situation palestinienne pour prévenir qu’elle se transforme en une idéologie politique oppressive, surtout que le peuple palestinien est aussi un aspect de l’histoire du salut qui continue de prendre cours dans l’histoire humaine44. Mais l’approche développée par R. Khoury ne se limite pas à critiquer ces diverses interprétations de type politique et idéologique ; l’auteur élargit cette vision en présentant une interprétation biblique qui part de la situation des Palestiniens et du monde arabe qui permette aux chrétiens de voir dans le Bible une référence de vie45.
Il est évident que l’interprétation biblique implique aussi une interprétation de plusieurs catégories bibliques46, comme la terre47, les promesses48, le peuple élu… L’interprétation palestinienne n’a pas manqué de le faire dans une perspective inclusive et universaliste, afin que la Parole de Dieu soit une source de libération, pour les oppresseurs et les opprimés49.
A partir des années 80, nous remarquons dans le monde le réveil du sentiment religieux comme élément identitaire dans les sociétés humaines. Dans l’aire chrétienne, nous pouvons mentionner le courant évangélique américain, qui s’est affirmé avec les ans et a conditionné la politique américaine entraînant des guerres sanglantes en plusieurs parties du monde (Afghanistan, Irak, etc.). Le même phénomène se vérifie dans le monde juif, en Israël et dans la diaspora, aboutissant à des positions politiques toujours plus extrémistes. Il en est de même dans le monde musulman. A partir de l’an 2000, ces tendances se sont raffermies et ont commencé à jouer un rôle important dans la politique internationale, toujours dans un sens négatif. Dans le monde arabe, ces tendances se sont répandues avec ce qu’on appelle « le printemps arabe » et ont abouti à des expériences féroces en plusieurs pays. Tout cela a mis sur le devant de la scène culturelle le problème de religion et de l’État.
En Palestine, ce problème ne pouvait pas ne pas concerner les théologiens engagés dans une réflexion théologique contextuelle, surtout que les Palestiniens aspirent à l’établissement d’un État palestinien indépendant. Le Forum International de Bethléem a centré sur ce thème sa 4ème conférence, dont les actes ont été réunis dans un livre50. En plus, le Forum a aussi organisé une série de rencontres au niveau du Moyen-Orient. Les fruits de ces rencontres ont été publiés dans un volume, regroupant des contributions de plusieurs pays (Palestine, Jordanie, Liban, Égypte)51.
Le centre Al-Liqa, pour sa part, a organisé sur ce sujet sa 25ème conférence du « Patrimoine commun » sous le titre Le projet national palestinien et l’État moderne, qui s’est concentré sur les divers modèles de l’État (l’État religieux, l’État laïque, l’État juif…). Les contributions sont surtout de caractère socio-politique, la contribution tant soit peu théologique ayant été présentée par R. Khoury52.
Comme nous l’avons indiqué au début de cet article, l’Université de Bethléem s’est mise elle aussi à organiser des conférences internationales, dont l’une a eu pour sujet la religion et l’État53. Mais, là aussi, les contributions sont plutôt de caractère socio-politique que théologique.
Nous pouvons dire que les contributions théologiques sur ce thème restent limitées. Il est certain que la théologie contextuelle palestinienne devrait approfondir cette question étant donné son importance pour l’avenir de la région, y compris la Palestine. Mais il faut dire aussi que la réflexion chrétienne en Palestine et dans le monde arabe s’oriente de plus en plus vers le concept de citoyenneté, étant, à leur avis, le seul capable de garantir une véritable égalité entre toutes les composantes d’une société on ne peut plus pluraliste comme est la nôtre en Palestine et dans le monde arabe. Il faut dire aussi que cette réflexion se situe de plus en plus entre deux pôles opposés : l’isolement et la fusion, pour développer une troisième voie, celle de l’appartenance et de l’authenticité. Par l’appartenance, ils évitent l’isolement et par l’authenticité, ils évitent la fusion54. Dans cette citoyenneté, la religion n’est pas exclue, mais elle est invitée à jouer un rôle fondamental, celui d’être la conscience des sociétés, au lieu d’être une force dominatrice et exclusive.
Le problème palestinien est au cœur de la théologie contextuelle palestinienne, comme la Nakba (catastrophe) est au cœur du problème palestinien. La théologie contextuelle est née de la confrontation de la conscience chrétienne palestinienne avec la tragédie du peuple palestinien. Que faut-il en penser? Que dire? Que faire? Quel est notre apport à la lutte du peuple palestinien pour ses droits légitimes et son indépendance? Dans quel sens et par quels moyens? Comment s’engager pour la justice et la paix? Comment dire notre parole propre sans pour cela nous dissocier de l’ensemble du peuple palestinien?…. Autant de questions difficiles et complexes, que la théologie contextuelle palestinienne a eu le courage d’affronter à la lumière de la foi avec les instruments théologiques dont elle dispose. La réflexion tourne autour d’un ensemble de valeurs qu’il importe d’harmoniser pour qu’elles soient un vrai chemin pour la paix. La paix, oui… mais quelle paix?
La paix dans la justice, répondent les théologiens palestiniens. La valeur de la paix55 est incontestable. Mais elle ne peut être séparée de la justice56. Les Palestiniens ne cessent de crier cette vérité bien haut et bien clairement, d’autant plus que ces deux valeurs sont inséparables dans la Bible: pas de paix sans justice. Or, la justice a été la valeur la plus oubliée dans les discussions de paix sur la scène internationale. La théologie contextuelle palestinienne est, en premier lieu, un cri pour la justice, parce que la plupart de ses protagonistes ont été les victimes de l’injustice, avec leurs familles, lors de la Nakba.
Il est significatif que le premier ouvrage de N. Ateek porte dans son titre le mot « justice »57, comme pour dire que cette valeur est le point de départ de toute recherche de la paix. Mais déjà dans ce livre, l’auteur rappelle d’autres valeurs inséparables de la justice, comme la paix, la compassion, l’amour, la miséricorde…58. En 2008, le même auteur a publié un autre livre, où il affirme vouloir continuer sa réflexion là où il l’a laissée dans son ouvrage précédent. Là encore, le titre est significatif: Un cri chrétien palestinien pour la réconciliation59. Aux valeurs mentionnées plus haut, il ajoute celles de vérité, de pardon et de réconciliation60. C’est ainsi que ces diverses valeurs, toutes bibliques, sont harmonisées et ensemble elles sont susceptibles de réaliser une vraie paix. Le centre Sabeel a publié aussi un bref document, en arabe et en anglais, sur une paix juste en Terre Sainte, où sont exposées succinctement, entre autres, les bases théologiques d’une paix juste61.
Le Patriarche M. Sabbah, de son côté, joue sur le même registre de valeurs, en en ajoutant d’autres non moins importantes, comme la liberté, l’indépendance, l’amour des ennemis, en plus de la justice qu’il ne cesse de rappeler… Dans un livre d’entretiens avec Yves Teyssier d’Orfeuil, le chapitre septième porte le titre de La paix sera le fruit de la justice62. En cela, il rejoint tous les autres protagonistes de la théologie contextuelle palestinienne. Dans un autre livre, qui réunit des textes choisis de ses prises de positions, il ne cesse là non plus de revenir sur ces mêmes valeurs dans des circonstances variées63.
A ces écrits, il faut aussi ajouter les interventions de l’évêque luthérien de Jérusalem, Mounib Younan, qui a réuni ses interventions majeures dans deux livres importants, où il est question de paix, de témoignage, de justice, de dialogue dans leurs diverses dimensions64.
Pour le centre Al-Liqa, depuis sa fondation, la question palestinienne, avec tous ses aspects (politique, culturel, historique, social, économique…), a toujours été au cœur de ses préoccupations. Cet intérêt s’est développé avec le temps au rythme des défis toujours nouveaux que les Palestiniens devaient sans cesse affronter. Cela s’est vérifié de plusieurs manières: par les articles innombrables dans la revue Al-Liqa, les conférences annuelles, les différentes initiatives sur le terrain, la publication de livres… Il suffit de parcourir l’index général de la revue Al-Liqa aux mots « Palestine », « Problème palestinien », « Nakba » et beaucoup d’autres pour s’en rendre compte65. A partir de l’an 2000, tous les grands événements que la Palestine et la région ont connus ont fait l’objet de réflexion, dans le but d’en étudier les retombées sur le problème palestinien. Si nous ne nous étendons pas sur cette très large production, c’est qu’elle est surtout de caractère politique.
Le document Kairos-Palestine mérite une mention à part. Il s’agit d’un document préparé par un groupe de chrétiens palestiniens, clercs et laïcs, des diverses Églises de la Terre Sainte, et publié après deux années de travail en commun. Le document se veut une parole chrétienne, c’est-à-dire une parole de « foi, espérance et amour », « du cœur de la souffrance palestinienne »66. Un cri d’espérance donc contre toute espérance, dans une situation où toutes les issues semblent fermées. Il constitue donc une protestation contre le désespoir et refuse de se plier à sa logique. Les auteurs de ce document veulent dire: nous sommes dans une voie qui semble sans issue, mais, au milieu de cette situation, nous avons un mot à dire, un mot qui est spécifiquement nôtre en tant que chrétiens, un mot important, et un mot qui ouvre les chemins de l’avenir67.
Sous le titre La réalité, la première partie décrit la situation présente à partir du mot de Jérémie: « Ils disent ‘Paix! Paix!‘ et il n’y a point de paix » (Jr 6, 14). « Tout le monde parle de paix, mais ce ne sont que des paroles. Alors que la réalité est l’occupation israélienne avec tout ce qui en résulte ». Et le document de dresser un tableau plutôt noir de cette réalité « avec tout ce qui en résulte », à savoir: le mur de séparation et tous problèmes qu’il entraîne sur la population palestinienne, la situation de Gaza sous l’embargo avec ce que cela signifie de punitions collectives, les colonies israéliennes qui ne cessent de grignoter les territoires palestiniens, les humiliations quotidiennes, la liberté religieuse, les réfugiés, les prisonniers, la situation à Jérusalem, l’atteinte au droit international et aux droits de l’homme, l’émigration, les punitions collectives et les représailles, etc. C’est à partir de cette réalité que les signataires du document développent leur vision de Foi, espérance et amour.
Une Parole de foi, en premier lieu, la foi en « un Dieu bon, juste et aimant toutes ces créatures », qui a pris un visage en Jésus-Christ, et en l’Esprit Saint « qui nous aide à comprendre les Écritures ». C’est justement à cette interprétation de l’Écriture que le document consacre une place prépondérante dans cette partie. Il suffit de rappeler ici les abus dont la Parole de Dieu est la victime pour justifier une situation flagrante d’injustice: « … il n’est pas permis de transformer la Parole de Dieu en une arme dans notre histoire présente, afin de nous priver de notre droit sur notre propre terre ». Les catégories de l’Ancien Testament (la terre, les promesses, l’élection…) sont présentées, à la lumière de Jésus-Christ dans un sens universaliste, comme étant des catégories qui embrassent « toute l’humanité, à commencer par tous les peuples de cette terre »; autrement, elles sont transformées en un programme « politique » et idéologique, qui ne peut être que destructeur. C’est dans cette perspective que le document affirme que « notre présence, en tant que Palestiniens – chrétiens ou musulmans – sur cette terre n’est pas un accident ». Aussi le document attire-t-il l’attention sur « certains théologiens occidentaux » qui développent une théologie qui, en fin de compte, donne « une légitimité théologique et scripturaire à l’injustice commise à notre égard ». « Parce que Palestiniens, nous souffrons à cause de l’occupation de notre terre, et parce que chrétiens, nous souffrons des fausses interprétations de certains théologiens ». « Nous déclarons donc que le recours à l’Écriture Sainte pour justifier ou soutenir des choix ou des positions politiques se fondant sur l’injustice, imposés par un homme à son prochain ou par un peuple à un autre, transforme la religion en idéologie humaine et prive la Parole de Dieu de sa sainteté, de son universalité et de sa vérité ». C’est dans ce cadre, que le document affirme « que l’occupation israélienne des Territoires palestiniens est un péché contre Dieu et la personne humaine ».
Ce document est ensuite une parole d’Espérance. Contre toute espérance, le document affirme que « notre espérance reste ferme » et cette espérance est le fruit de notre foi. Et le document d’expliquer: « Espérer veut dire ne pas se résigner devant le mal, mais dire non à l’oppression et à l’humiliation, et continuer à résister au mal ». Parmi les quelques signes d’espérance énumérés, le plus important me semble être le suivant: « De plus, nous voyons, chez beaucoup de gens, une détermination à dépasser les rancunes du passé. Ils sont prêts à la réconciliation une fois la justice établie. Le monde prend conscience de la nécessité de restaurer les droits politiques des Palestiniens. Des voix juives et israéliennes plaidant pour la paix et la justice s’élèvent à cette fin… Il est vrai que ceux qui sont pour la justice et la réconciliation restent impuissants à mettre fin à l’injustice. Ils représentent cependant une force humaine qui a son importance et pourrait abréger le temps de l’épreuve et rapprocher celui de la réconciliation ». C’est dans ce cadre aussi que le document affirme la « mission prophétique » de l’Église, « qui proclame la Parole de Dieu dans le contexte local et dans les événements quotidiens, avec audace, douceur et amour ». « Nous sommes appelés à prier et élever notre voix pour annoncer une société nouvelle où les hommes croient en leur dignité et en celle de leur adversaire ».
C’est, finalement, une parole d’amour. C’est dans cette partie que le document affronte le problème de la résistance. Il commence par affirmer la primauté du commandement de l’amour, qu’il explique de cette manière : « Aimer c’est voir le visage de Dieu en tout être humain. Toute personne est mon frère et ma sœur », pour ensuite poursuivre: « Néanmoins, voir le visage de Dieu en toute personne ne veut pas dire consentir au mal ou à l’oppression de sa part. L’amour consiste plutôt à corriger le mal et à arrêter l’oppression ». Et l’occupation israélienne « est un mal auquel il faut résister ». Le document explique la forme de cette résistance: « Nous disons que notre option chrétienne face à l’occupation israélienne est la résistance: c’est là un droit et un devoir des chrétiens. Or cette résistance doit suivre la logique de l’amour. Elle doit donc être créative, c’est-à-dire qu’il lui faut trouver les moyens humains qui parlent à l’humanité de l’ennemi lui-même. Le fait de voir l’image de Dieu dans le visage de l’ennemi même et de prendre des positions de résistance à la lumière de cette vision est le moyen le plus efficace pour arrêter l’oppression et contraindre l’oppresseur à mettre fin à son agression et, ainsi, atteindre le but voulu : récupérer la terre, la liberté et l’indépendance ».
Après tout cela, le document se termine par une série d’appels : premièrement aux chrétiens palestiniens eux-mêmes, un appel à l’espérance et à l’action ; ensuite, aux Églises du monde, les invitant « à prendre le parti de l’opprimé », à la communauté internationale, l’invitant « à une action sérieuse pour une paix juste et définitive, qui mette fin à l’occupation israélienne des Territoires palestiniens et d’autres territoires arabes occupés, et qui garantisse la sécurité et la paix à tous », aux chefs religieux juifs et musulmans, les invitant à s’élever « au-dessus des positions politiques » pour œuvrer pour le bien de « toute personne humaine »; finalement, aux Palestiniens et aux Israéliens, les invitant « à voir le visage de Dieu en chacune de ses créatures , et à aller au-delà des barrières de la peur ou de la race, pour établir un dialogue constructeur »,afin de « parvenir à une vision commune bâtie sur l’égalité et le partage, non sur la supériorité, ni sur la négation de l’autre ou l’agression, sous prétexte de peur ou de sécurité », surtout à Jérusalem, « habitée aujourd’hui par deux peuples et trois religions ».
Ce document n’aurait pu voir le jour sans l’évolution qui s’est vérifiée dans la communauté chrétienne depuis les années 70. En effet, nous remarquons dans une couche assez importante de la communauté chrétienne depuis cette date une plus grande conscience de sa foi et de son importance dans leurs options et engagements dans la société. La théologie contextuelle a suivi cette évolution et l’a nourrie de sa réflexion. Le document Kairos-Palestine est un des fruits de cette évolution. La théologie contextuelle palestinienne a permis de donner à ce document un cachet théologique et biblique68. Il s’inscrit donc bien dans ce courant.
Parallèlement, au milieu des changements de contexte, s’est manifestée une orientation de plus en plus marquée de la société palestinienne vers la résistance non-violente, que M. Sabbah résume en cette parole: « Non à la violence, non à la résignation »69. Cette forme de lutte ne cesse de se traduire en des initiatives sur le terrain : protestations contre le mur de séparation, la confiscation des terres, les colonies et beaucoup d’autres formes. On peut dire que Kairouan Palestine est la charte chrétienne palestinienne de la résistance non-violente70. Dans ce cadre, les centres Al-Liqa et Sabeel ont organisé conjointement une conférence sur le thème de la résistance non violente, dont les actes ont été publiés71 ; toutes les contributions à cette conférence ont pour auteurs des personnes engagées, d’une manière ou d’une autre, dans la résistance non-violente sur le terrain, ce qui fait que ce livre constitue un manuel de la résistance palestinienne non violente72.
Par ailleurs, Kairos-Palestine est en train de se transformer en un mouvement, qui s’efforce de divulguer ce document dans le monde, afin de créer un réseau international de solidarité avec la résistance palestinienne non violente73.
Que signifie être chrétien en Palestine et dans le monde arabe? En quoi consistent la vocation, la mission et le témoignage des chrétiens palestiniens et arabes dans leurs sociétés?…. Ces questions n’ont cessé d’être des sujets de réflexion permanente dans les cercles de la théologie contextuelle palestinienne. Ici, nous nous limitons aux contributions de caractère théologique.
Sur ce point encore le centre Al-Liqa a été un des pionniers. Depuis sa fondation il a accordé une importance particulière à cette réflexion, qui s’est encore intensifiée au cours des années. Cet intérêt s’est vérifié à plusieurs niveaux. Nous mentionnons ici les contributions à partir de l’an 2000.
Tout d’abord à travers les conférences annuelles. Il suffit d’énumérer celles qui ont eu pour sujet la présence chrétienne, surtout dans la branche de « Théologie et Église locale »: « Où va la présence chrétienne? » (Xème conférence, 2003), dans laquelle la présence chrétienne a été présentée dans ses divers aspects, politique, économique, culturelle…74; à la XIème conférence (2004), le centre Al-Liqa est sorti des Territoires palestiniens pour étendre son champ d’intérêt à la Galilée sous le titre « l’Église de Galilée aujourd’hui entre le passé et l’avenir »75; à ce dossier, il faut ajouter un autre sur les jeunes chrétiens de Galilée, sous ses divers aspects, surtout celui de leur crise d’identité (XVIIème conférence, 2010)76; « Les arabes chrétiens en Terre Sainte: Identité et appartenance » (XIIIème conférence, 2006), où la question d’identité a été l’objet de différentes approches, avec tous les défis qu’elle affronte, dans une perspective d’avenir77. La XVIIIème conférence a eu une importance particulière, puisqu’elle a insisté sur la foi comme base de la présence chrétienne en Palestine et en Orient en général. Ainsi, la réflexion passe d’une présence basée sur des facteurs socioculturels à une présence basée sur la foi, comme l’indique son titre: « De l’identité de foi à une présence effective »78. Après un regard critique sur notre présence dans le passé, surtout au XIXème S. (R. Khoury)79, la physionomie du chrétien est décrite dans sa relation à sa foi (Patriarche M. Sabbah)80, une foi qui aboutit à son identité ecclésiale (J. Khader et B. Sayyah)81. Et tout cela est la base de sa présence dans la société (G. Khoury) et sa relation avec les autres (I. Mouallem et G. Khoury82). Quant à la XXème conférence, elle aussi a eu une importance spéciale puisqu’elle a voulu concentrer la réflexion sur la libération de la communauté chrétienne des résidus psychologiques et sociaux négatifs du passé qui entravent son élan83. Après une introduction sur la libération en général (J. Khader)84, les deux contributions majeures ont été celle de R. Khoury85 et de G. Khoury86 ; les autres ont eu pour sujet la présence chrétienne sous ses divers aspects (M. Sabbah , I. Mouallem, B. Sabella et autres).
La présence chrétienne aujourd’hui est inséparable de l’expérience du passé, à savoir celle de nos ancêtres entre le 8ème et le 14ème S, qui a produit une large littérature, dont une bonne partie est de caractère théologique, qui a reçu le nom de Patrimoine Arabe Chrétien. La revue Al-Liqa avait déjà publié sur le sujet un dossier spécial87, et, après l’an 2000, une conférence88.
Il faudrait encore y ajouter que la revue Al-Liqa a toujours consacré un numéro spécial sur les visites des divers papes en Terre Sainte pour souligner leur importance pour la présence chrétienne en Palestine89 ?
La contribution du centre Al-Liqa sur le sujet de la présence chrétienne ne se limite pas à ces conférences, mais elle s’étend aussi à l’activité éditoriale. Pendant la période qui nous concerne, le centre a publié deux livres qui traient de la présence chrétienne en Palestine et dans l’Orient arabe. Le premier est de G. Khoury, qui a réuni les divers articles écrits sur ce thème dans les années précédentes90, tandis que le second est de R. Khoury qui, lui aussi, rassemble dans ce volume ses divers écrits sur la présence chrétienne, après les avoir révisés et complétés à la lumière des derniers événements91. Dans ces deux volumes, un regard est jeté sur les diverses dimensions de la présence chrétienne, le passé, le présent et l’avenir. Pour ce qui est du passé, R. Khoury présente un panorama général de la présence chrétienne en Orient et en Palestine au cours des diverses périodes de l’histoire (premiers siècles, période musulmane, période ottomane, temps modernes à partir du dix-neuvième S.), relevant surtout les empreintes que chaque période a laissées sur la physionomie des chrétiens et de leurs Églises92. A ce panorama général, l’auteur ajoute une étude critique de cette présence, surtout à l’époque moderne, à partir de la renaissance arabe ; sa thèse fondamentale est que cette présence a été commandée par des motifs idéologiques, en marge de la foi et même contre la foi, plutôt que par des motifs inspirés par la foi93. Quant à lui, G. Khoury se contente de la période musulmane pour mettre en relief quelques aspects de la présence culturelle des chrétiens pendant cette période (contribution à la vie culturelle, la raison et la foi, l’Évangile, morale)94.
Pour ce qui est du présent, R. Khoury a deux articles : l’un étudie les défis qu’affrontent les chrétiens actuellement, concernant la foi, l’Église et la présence dans la société95, tandis que l’autre traite de la présence chrétienne dans le contexte des « révolutions » arabes, où sont exprimées les espérances et les peurs des chrétiens arabes dans le contexte de ces révolutions96. Pour sa part, G. Khoury présente, dans la deuxième partie de son livre, plusieurs aspects de cette présence actuelle : défis historiques et politiques97.
Pour ce qui est de l’avenir, R. Khoury pense qu’il est lié à la qualité de la foi. Renouveler la présence des chrétiens en Orient et en Palestine signifie avant tout renouveler leur foi. Sur ce sujet, l’auteur présente trois études. Dans le premier, il expose un projet de nouvelle évangélisation dans les Églises d’Orient à partir de leur situation concrète98; dans le second, il s’arrête surtout à la foi dans le Christ à partir de la question de Jésus : Qui dites-vous que je suis?99; le troisième traite d’une question particulière, à savoir l’importance de la tradition orientale et de la nécessité de la mettre au service de la présence chrétienne aujourd’hui100. G. Khoury, de son côté, voit cet avenir dans une Église incarnée dans son milieu et qui soutient le chrétien dans son identité d’arabe ou de palestinien chrétien101.
Si nous nous sommes arrêtés longuement à la contribution du centre Al-Liqa, c’est que ce thème a été son souci permanent et systématique. Toutefois notre intention n’est pas de laisser dans l’ombre d’autres contributions non moins importantes. Le centre Sabeel a organisé sa sixième conférence internationale (2006) sur le thème de la présence chrétienne en Terre Sainte, avec la collaboration d’auteurs locaux et étrangers. La conférence couvre les aspects historiques (la période byzantine, avant l’Islam, les facteurs historiques qui ont affecté le christianisme palestinien), la situation actuelle, les problèmes qu’affrontent les chrétiens de la Terre Sainte et les perspectives d’avenir102.
Les cercles du Forum International de Bethléem se sont eux aussi penchés sur la question de la présence chrétienne en Palestine et dans le monde arabe. M. Raheb a publié plusieurs livres sur ce sujet, où il reprend des articles qu’il a écrits au cours des dernières décennies et dans lesquels il expose, sans une méthodologie systématique, plusieurs aspects de la présence chrétienne (panorama historique, le christianisme dans la péninsule arabique avant l’Islam), sans oublier la situation actuelle (la situation actuelle de la communauté chrétienne palestinienne, les révolutions arabes actuelles…)103. Dans ces mêmes cercles, il faut mentionner aussi deux livres de l’évêque luthérien de Jérusalem, M. Younan, qui traitent de la présence chrétienne sous le signe du témoignage et du dialogue à partir surtout de l’expérience luthérienne en Palestine104.
La Palestine est au carrefour de trois continents (Afrique, Asie, Europe) et au carrefour des trois religions monothéistes; y sont aussi présentes presque toutes les Églises, orientales et occidentales. Elle est par conséquent un lieu idéal pour le dialogue entre les peuples, les religions et les Églises. Mais c’est là aussi que le dialogue est des plus difficiles et des plus ardus à cause des poids de l’histoire et des problèmes politiques irrésolus. Toutefois, la théologie contextuelle palestinienne n’a pas hésité à affronter la problématique du dialogue, sur le plan de la théorie et de la pratique. D’ailleurs les noms des grands centres que nous avons mentionnés suggèrent le dialogue: Al-Liqa veut dire « rencontre », An-Nadwa veut dire « Forum », et Sabeel veut dire la « fontaine du village » où tout le monde se rencontre pour puiser l’eau. Ces trois centres sont donc aussi des plates-formes de rencontre et de dialogue, d’une manière ou d’une autre. On peut envisager leur contribution autour de ce sujet sous quatre titres: dialogue, œcuménisme, relations islamo-chrétiennes, dialogue interreligieux.
Le centre Al-Liqa s’est arrêté, à plusieurs reprises, sur l’idée de dialogue, qui a sa source dans le dialogue trinitaire105, et a pris corps en Jésus-Christ, dans lequel continue le dialogue entre Dieu et les hommes et entre les hommes eux-mêmes106. Un des dossiers de la revue Al-Liqa porte le nom de « Le dialogue ou la mort »107. Le dialogue n’est pas une activité passagère, mais plutôt un état d’âme ou une attitude existentielle, qui fait partie du moi de l’homme. C’est dans cette ligne qu’un dossier de la revue Al-Liqa porte le titre « Du dialogue des cultures à la culture de dialogue »108. Une question qui est en rapport étroit avec celle du dialogue est celle de l’identité. Quelle identité: Ouverte ou fermée? Inclusive ou exclusive?…109.
Les trois centres mentionnés plus haut se présentent comme des centres œcuméniques. En effet, parmi leurs membres se trouvent des chrétiens de toutes les Églises de Terre Sainte. Ils organisent aussi des activités de type œcuménique. Le centre Sabeel, à titre d’exemple, organise régulièrement des retraites spirituelles et des sorties œcuméniques, ainsi que des réunions rassemblant des clercs de différentes Églises… Il en est de même des autres centres110.
En ce qui concerne la réflexion œcuménique, il faut relever que le centre Al-Liqa111 est le seul au Moyen-Orient qui a publié tous les textes œcuméniques des dialogues entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe et entre l’Église catholique et les Églises orthodoxes orientales, comme aussi les textes œcuméniques entre les diverses Églises non-catholiques, tout en y ajoutant des commentaires théologiques et historiques par d’éminents spécialistes de l’œcuménisme au Moyen-Orient (F. Bouwen, J. Corbon, L. Lahham, P. G. Gianazza..)112. Nous ne pouvons que mentionner ici le rôle œcuménique joué par le Patriarche Sabbah, surtout sur le plan pratique113.
Le centre Al-Liqa a été fondé en premier lieu pour promouvoir les relations islamo-chrétiennes en Palestine. Il a été pionnier dans ce domaine. Depuis lors, il est resté fidèle à cette option. En effet, il organise ponctuellement ses conférences autour de ce thème sous ses divers aspects, suivant en cela l’évolution de ces relations en Palestine, au Moyen-Orient et dans le monde: Islamophobie, tension entre l’Occident (chrétien) et l’Orient musulman, développement de l’Islam politique avec ses manifestations extrémistes et violentes etc. Il suffit de passer en revue les titres de ses conférences depuis l’an 2000 pour s’en rendre compte: « Musulmans et chrétiens ensemble: Passé, présent et avenir (XVIème conférence, 2000)114; « La construction de la confiance entre le monde arabe et musulman et l’Occident: Expériences du passé et perspectives d’avenir » (XXIème conférence, 2009)115; « Entre l’Orient et l’Occident. Vers un discours modéré et universel » (XXIIème conférence, 2010)116; « Où vont les révolutions arabes » (XXIIIème conférence)117; « Encore et encore… Les révolutions arabes » (XXIVème conférence, 2012)118. En dehors de ces conférences, la revue Al-Liqa ne cesse de revenir sur ce thème sous ses multiples aspects.
En plus de ces conférences et articles, il faut mentionner deux livres de G. Khoury, directeur du centre Al-Liqa, sur les relations islamo-chrétiennes. Le premier est un recueil d’articles écrits à diverses périodes. Il y étudie les relations islamo-chrétiennes dans le passé (entre la conquête arabe et les croisades), dans le présent (Le monothéisme comme facteur d’unité entre musulmans et chrétiens, Le dialogue entre chrétiens et musulmans arabes en Terre Sainte, les relations islamo-chrétiennes dans le nouvel ordre mondial, Le rôle de l’éducation religieuse pour approfondir l’unité nationale, Le devoir des arabes envers l’Église locale…)119. Le deuxième est un livre sur Sophrone, patriarche de Jérusalem lors de la conquête musulmane, dont la figure est une référence pour les relations islamo-chrétiennes. Tout le monde connaît cette figure, mais superficiellement, il faut le dire. G. Khoury s’est donné la peine de l’approfondir sous ses aspects divers (historique, théologique, ecclésial…) au-delà des légendes et des mythes. Un chapitre spécial a été consacré à la charte de protection que Omar a octroyé aux chrétiens de Jérusalem et qui reste une référence primordiale pour les relations islamo-chrétiennes en Palestine. En plus de cette étude sur la figure de Sophrone, il a aussi édité, dans le même volume, un écrit attribué à Sophrone, dans sa traduction arabe ancienne et une étude sur cet ouvrage. Le tout constitue une référence de premier ordre en langue arabe120.
A cette activité intense du centre Al-Liqa, il faut ajouter la contribution de l’Université de Bethléem, qui a organisé trois conférences internationales sur les relations islamo-chrétiennes. Le premier a eu pour sujet l’expérience de la cohabitation entre chrétiens et musulmans dans diverses parties du monde (Belgique, Suède, Jordanie, États-Unis, Philippines), et à l’intérieur de l’Université de Bethléem elle-même (J. Khader, plusieurs étudiants) et en Palestine (B. Sabella et R. Khoury)121. Le second a choisi l’approche des relations islamo-chrétiennes sous l’angle de l’éducation et des mass-médias122. La troisième traite de la violence dans son rapport avec la religion, avec des contributions internationales et locales123. Il faut y ajouter la contribution de J. Khader (avec B. Fawzi) sur les principes du dialogue entre les religions pour résoudre les conflits124.
On ne peut pas non plus passer sous silence un essai de P. Du Brul, professeur à l’Université de Bethléem, sur le Coran, où il essaie de donner quelques clés de lecture du Coran de l’intérieur même du Coran. Cet essai, qui a scandalisé certains, habitués à la polémique, et a été critiqué par d’autres, reste une tentative intéressante au-delà de la polémique et de l’apologétique. Il a été présenté aux élèves chrétiens pour les aider à comprendre le Coran125.
Parmi les moyens pratiques pour développer la cohabitation entre musulmans et chrétiens viennent en premier lieu l’école126 et les médias127.
Le dialogue interreligieux est un lieu de réflexion dans la théologie contextuelle palestinienne, du fait de la présence, en Terre Sainte, des trois religions monothéistes. Mais il faut dire que ce genre de dialogue est peu pratiqué à cause de la situation politique qui brouille l’atmosphère. Cependant des essais ont été faits sporadiquement ici ou là. A titre d’exemple, la revue Al-Liqa, dans quelques-uns de ses dossiers, a donné la parole à des croyants des diverses religions (sur des thèmes, comme l’homme de religion128, Jérusalem129), mais de telles initiatives sont restés sans lendemain.
Malgré les difficultés d’un tel dialogue, M. Younan a déployé un effort assidu dans ce sens, tant sur le plan pratique que spéculatif. En effet, pendant de longues années, il a essayé d’organiser des rencontres interreligieuses à Jérusalem entre chrétiens, juifs et musulmans, d’Israël et de Palestine. Aussi, sur le plan de la réflexion, il y a lieu de mentionner une réflexion intéressante sur ce sujet, où il développe l’idée de « Trialogue »130.
En dehors des milieux chrétiens, il est intéressant de noter les activités du centre Passia (Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs), qui a organisé plusieurs sessions de travail de caractère interreligieux autour de personnages bibliques (Abraham, Joseph, Moise, Jésus, en plus de Jérusalem131).
Dans ce cadre, on peut attirer l’attention sur la contribution de J. Khader, qui s’oriente de plus en plus vers l’exploration du rôle de la religion comme facteur de paix132.
Dans l’histoire, on ne connaît que le récit des vainqueurs. Les vaincus n’ont pas de voix. En Terre Sainte, pendant longtemps, on ne connaissait que le récit des vainqueurs (les Israéliens), les Palestiniens ayant peu écrit sur leur expérience concrète de la Nakba. Mais depuis quelques décennies, ces récits concernant la Nakba et la vie de tous les jours ont commencé à voir le jour133, à commencer par l’œuvre poétique de Mahmoud Darwish134, sans oublier les œuvres d’art plastique (Ismail Shammout, Sleiman Mansour et beaucoup d’autres). Les chrétiens ont largement contribué à cette littérature: Elias Chacour135, Emile Shoufani136, Mitri Raheb137, Viola Raheb138, Mounib Younan139, Raja Shehadeh140, Geries Khoury141, Rifat Kassis142 et autres143.
Nous n’hésitons pas à ranger ces expériences dans la bibliothèque de la théologie contextuelle sous le titre de Théologie Narrative. En effet, lorsqu’ils décrivent leurs expériences, ils le font en tant que croyants, qui pensent que la main de Dieu est dans les événements qu’ils vivent avec leurs familles et leur peuple. Ils y expriment leur attachement à la terre, à leur peuple, à leur foi, et la signification que cette appartenance signifie pour eux. Dans un sens, ils imitent plusieurs livres de l’Écriture Sainte, qui racontent une histoire, mais tout au long de cette histoire, une lecture attentive peut discerner des soubassements théologiques sur lesquels le récit est fondé. On peut dire que ces récits ont un caractère théologique, comme les Actes des Apôtres et bien des livres de l’Ancien Testament (Tobie, Judith, Esther et l’Exode).
Jérusalem est une ville unique, un mystère même, où Dieu ne cesse de se révéler aux hommes d’une manière ou d’une autre. Étant au confluent des trois religions monothéistes, elle ne cesse de nous provoquer et de nous inviter à aller plus loin. C’est là surtout que les grandes questions de l’humanité sont constamment posées: Qui est Dieu? Qui suis-je? Qui est l’autre? Quelle relation entre Dieu et l’homme? Entre l’homme et son prochain? Quelle relation entre le temps et l’éternité? Entre le ciel et la terre?… Ce n’est pas sans raison qu’elle a été décrite comme « un laboratoire », sinon un « lieu théologique », c’est-à-dire un point de référence obligé pour la réflexion théologique144.
La pensée chrétienne en Palestine s’est penchée sur la question de Jérusalem depuis ses débuts. Les chefs religieux chrétiens de Jérusalem ont publié un document sur la Ville Sainte sous le titre « Vision de Jérusalem »145. Le centre Al-Liqa, de son côté, a publié un document sur Jérusalem146, comme il a publié un volume de 592 pages où il rassemble les divers écrits sur Jérusalem dans les cercles du centre Al-Liqa147.
Depuis l’an 2000, cet intérêt s’est poursuivi. Nous nous arrêtons aux contributions les plus significatives, surtout du point de vue théologique. La revue Al-Liqa a publié tout un dossier sur Jérusalem à l’occasion de la proclamation de Jérusalem comme capitale de la culture arabe, avec des contributions musulmanes et chrétiennes148. Des points de vue théologiques ont été développés par plusieurs protagonistes de la théologie contextuelle palestinienne: N. Ateek149, M. Younan150, M. Raheb151, V. Raheb152, G. Khoury153. Quant au Patriarche Michel Sabbah, il n’a cessé de revenir à ce thème, pour en relever les divers aspects de la Ville Sainte, dans ses dimensions politiques, religieuses et ecclésiales154.
Jérusalem n’occupe pas encore la place qu’elle mérite dans la réflexion de la théologie contextuelle palestinienne. Elle mérite certainement davantage. Nous espérons que les années à venir puissent attirer l’attention sur cette ville qui reste une source d’inspiration.
Il est certain que la théologie contextuelle palestinienne a fait un pas significatif en avant dans les dernières quinze années, après les débuts plutôt timides des années 80, quant aux sujets abordés, aux thèmes traités, et je dirais même quant aux instruments théologiques. Il revient aux théologiens professionnels d’explorer cette vaste production pour en dresser le bilan, avec ses côtés positifs, mais aussi négatifs. Il est certain que ce chemin de la théologie contextuelle palestinienne est à poursuivre pour le bien de la communauté chrétienne en Palestine, comme aussi pour le peuple palestinien et tous les habitants de cette terre bénie. Comme nous avons eu l’occasion de le dire en une autre occasion, ce chemin ne peut être poursuivi que par un travail commun. Il serait important que tous les centres qui s’intéressent à cette théologie, de même que ses protagonistes les plus en vue, puissent travailler ensemble, pour délimiter le chemin parcouru et le chemin encore à faire. Ce travail en commun donnerait sans aucun doute un nouvel élan à cette théologie. Il serait dommage de s’arrêter à mi-chemin, car la route à parcourir est encore longue155.
Nous ne voudrions pas terminer sans attirer l’attention sur le fait que cette réflexion des chrétiens palestiniens est inséparable de celle qui s’effectue dans l’Orient arabe, au Liban156, en Syrie, en Égypte…). En effet, nous constatons depuis quelques années une multiplication d’efforts pour le développement d’une théologie contextuelle arabe. Il suffit de mentionner les diverses initiatives qui sont prises dans ce domaine au Séminaire du Patriarcat maronite de Ghazir157 et par le Congrès sur la théologie orientale à Ain Traz158. Une mention spéciale doit être faite des Lettres Pastorales des Patriarches catholiques d’Orient, surtout les six premières, qui contiennent de véritables semences théologiques159. Tout cet effort nous invite à croire que le moment est venu d’essayer une synthèse théologique moderne en arabe, avec la collaboration des théologiens de l’ensemble du monde arabe160.
A chaque époque ses théologiens. Dans le monde arabe il est plus que jamais nécessaire que les théologiens se penchent sur les problèmes de leur monde dans une perspective de foi et avec les instruments théologiques contemporains. Ils rendront ainsi un grand service à leurs peuples et à leurs sociétés, comme aux communautés chrétiennes dans le monde arabe. En effet, le monde arabe passe par une période critique de son histoire, qui est déterminante pour son avenir. Il importe de reconnaître que les problèmes qui y sont posés ont aussi leurs dimensions théologiques : Qui est Dieu? Qui est l’autre?…. Il serait dommage que les théologiens arabes soient absents de cette tourmente historique. Il est plus nécessaire que jamais de projeter la lumière de la Parole de Dieu sur une situation de plus en plus dramatique, et cela de manière concrète, à partir de l’appel de nos peuples et de nos communautés chrétiennes. La réflexion théologique y a sa part. Une théologie contextuelle est plus urgente que jamais.
1 R. Khoury, « Palestinian Contextual Theology: Its March and its Message », in Al-Liqa’ Journal (édition anglaise), Vol. 14/15, Dec. 2000, pp. 39-89, qui est la traduction de l’arabe d’une conférence présentée à la 5ème conférence du programme « Théologie et Église locale » (1991) du centre Al-Liqa et publiée dans les Actes de cette conférence (en arabe). Une traduction allemande de cette étude se trouve dans: Zwischen Halbmond und Davidstern. Christliche Theologie in Palästina heute, hg. von Harald Suermann, Freiburg im Breisgau, 2001, pp. 52-100. Une synthèse revue et augmentée de cet article peut être trouvée en français: R. Khoury, « Faire théologie en Palestine », in Quo Vadis, Theologia Orientalis? Actes du Colloque « Théologie Orientale: contenu et importance », Ain Traz, avril 2005, CEDRAC, Université Saint-Joseph, Beyrouth – 2008, pp. 61-80. À l’aube de l’an 2000, la revue Al-Liqa a essayé de faire le point sur cette théologie à travers des interviews (N. Ateek, E. Chacour, M. Raheb, G. Khoury) et de petits articles attirant l’attention à tel ou tel aspect de cette théologie (P. G. Gianazza, M. Younan, F. Bouwen, J. Khader, R. Khoury, et autres): Cf. la revue Al-Liqa, vol. XIV, n. 1, 1999, pp. 4-136 (en arabe). Une synthèse en langue allemande de cette théologie avant la période qui nous intéresse ici peut être trouvée dans: D. Biestmann-Kotte, Die Menschen, das Land und der Ölzweig. Palästinensische Christen für Frieden und Gerechtigkeit, Berlin 2002 (surtout les chapitres 4 et 5). Il faut dire que cette synthèse est forcément limitée, puisqu’elle se base sur la production de cette théologie en langues étrangères. Pour la période qui précède l’an 2000, cf. surtout U. Gräbe, Kontextuelle palästinensische Theologie, Heildelberg, 1998. Pour les caractéristiques de la théologie contextuelle palestinienne, cf. G. Khoury, « Programma per la teologia contestualizzata palestinese », in Un Palestinese porta la sua croce, Bologna, 2009, pp. 173-210 (en italien).
2 Il est à remarquer que le centre Al-Liqa est revenu plus d’une fois sur la théologie contextuelle palestinienne pour en faire le point. En plus du dossier rappelé dans la note précédente, il faut mentionner une conférence qui a été consacrée à ce thème sous le titre de Quelle théologie pour quel avenir?, XVIème conférence de « Théologie et Église locale », Al-Liqa, vol XXIV, n. 1, 2009. Plusieurs protagonistes de cette théologie y ont participé, entre autres M. Raheb (« Quelle théologie dans les Églises du Moyen-Orient en général et dans l’Église de Terre Sainte en particulier », pp. 49-67); R. Khoury (« Une nouvelle pensée chrétienne pour des temps nouveaux: Les lettres pastorales des Patriarches catholiques d’Orient », pp. 96-94); J. Khader (« Les défis palestiniens et la pensée théologique », pp. 95-105, en arabe), et autres, pour essayer d’ouvrir de nouveaux chemins à cette théologie.,
3 Le Forum International (An-Nadwa) a publié un livre sur les révolutions arabes: Le printemps arabe et les chrétiens du Moyen-Orient, édité par M. Raheb, qui rassemble des articles écrits par des chrétiens de diverses parties du monde arabe, Bethléem, 2012 (en arabe). Ce sont des articles écrits au début des événements et qui reflètent l’enthousiasme des débuts. Cf. aussi: M. Raheb, « The Revolution in the Arab World: Towards a Public Theology of Liberation »; in Sailing Through Troubled Waters. Christianity in the Middle East, Bethlehem, 2013, pp. 107-118.
4 Document de base : Théologie et Église Locale, Bethlehem, 1987 (en arabe et en anglais).
5 Index de la revue Al-Liqa 1985-2010, Bethlehem, 2011. Cet index comprend une table analytique de chaque volume, comme aussi une table analytique des auteurs et des sujets (en arabe).
6 Cf. le numéro spécial à l’occasion de ses 25 ans, vol. XXVI, n. 1-2, 2011, où la contribution de la revue est relevée dans les divers domaines: La théologie contextuelle, la présence chrétienne, les relations islamo-chrétiennes, le problème palestinien, l’œcuménisme, etc. (en arabe).
7 Cf. N. Ateek, R. R. Reuther, M. Grey, « Twenty-five years of Palestinian Liberation Theology », in The Bible and the Palestine Israel Conflict, pp. 279-293; N. Ateek, « The Birth of Sabeel », in A Palestinian Christian Cry for Reconciliation, New York, 2008, pp. 3-14.
8 Quelques titres, entre beaucoup d’autres: « Dossier: Faire mémoire… Père Jean Corbon. L’œcuménisme au service de la présence chrétienne au Moyen-Orient » qui reprend les actes d’un colloque organisé au Liban sur le P. Jean Corbon, auteur d’un livre (Église des Arabes) qui peut être considéré l’un des chefs-d’œuvre d’une théologie contextuelle au Moyen-Orient, Tome 52, 2002, Fasc. 1-2; R. Wtorek, « Une société plurielle est-elle possible? Entre utopie et idéologie au Moyen-Orient. Une étude des enjeux du dialogue islamo-chrétien d’après trois lettres pastorales des patriarches catholiques d’Orient », Tome 53, 2003, Fasc. 1-2, pp. 63-85 et Tome 53, 2003, Fasc. 3-4, pp. 319-340; M. Sabbah, « Chrétiens et musulmans pour une société palestinienne nouvelle », Tome 54, 2004, Fasc. 1-2, pp. 71-76; R. Khoury, « Les chrétiens de Terre Sainte: expérience historique et réalité présente », Tome 57, 2007, Fasc. 3-4, pp. 291-317; J. Khader et D. Neuhaus, « Le dialogue interreligieux en Terre Sainte quarante ans après Nostra Aetate », Tome 56, 2006, Fasc. 3-4, pp. 299-310; F. Daou, « Religion et politique dans une société pluraliste: réflexions libanaises », Tome 57, 2007, Fasc. 1-2, pp. 86-102; M. B. Aoun, « Pour une théologie arabe de la libération: contribution à l’étude de la pensée de Grégoire Haddad », Tome 59, 2009, Fasc. 1-2, pp. 52-76; A. Fleyfel, « Éléments pour une théologie contextuelle arabe », Tome 62, 2012, Fasc. 3-4, pp. 261-289; F. Sidarouss, « L’Église d’Égypte, peuple de prophètes, de rois et de prêtres. Lecture théologique de la révolution de janvier 2011 », Tome 63, 2013, Fasc. 1-2, pp. 6’-84.
9 Il me semble que le livre édité par H. Suermann en allemand, avec la collaboration de plusieurs représentants de cette théologie (Geries Khoury, Mounib Younan, Rafiq Khoury, Mitri Raheb, Michel Sabbah et autres), représente un survol des principaux thèmes de cette théologie (justice et paix, interprétation biblique, identité de l’Église locale, œcuménisme, Jérusalem…): Zwischen Halbmond und Davidstern. Christliche Theologie in Palästina heute, hrsg. von H. Suermann, Freiburg im Breisgau, 2001 (nous y reviendrons au cours de cet article).
10 Cf. le dossier de 247 pages, publié par la revue Al-Liqa sur ce sujet sous le litre « Le synode diocésain des Églises catholiques de Terre Sainte », vol. XV, n. 3-4 (2000) (en arabe).
11 Assemblée des Ordinaires Catholiques de Terre Sainte – Synode Diocésain, Plan Pastoral Général, Jérusalem, 2001, 192 pages (en plusieurs langues).
12 Voir: « Dossier: De l’identité de foi à la présence effective », revue Al-Liqa, vol. XXVII, n. 3, 2012, pp. 35-138 (en arabe).
13Ibid. pp. 35-40 (introduction au dossier).
14 « Physionomie du croyant et les caractéristiques de sa personnalité dans nos pays », ibid. pp. 67-74.
15 « L’identité de l’Église au XXIème siècle en Terre Sainte », ibid., pp. 75-85.
16 « Comment développer le chemin de renouveau dans l’Église », ibid., pp. 119-125.
17 « La sensibilisation à la présence chrétienne dans notre société et les défis qu’elle affronte », ibid. pp. 86-109.
18 « Nous et les autres », ibid., pp. 109-117.
19 « Nouveaux horizons dans notre relation avec les autres », ibid., pp. 126-132.
20 « Les défis actuels de la présence et du témoignage chrétiens dans l’Orient arabe », in Pour des frontières ouvertes entre le temps et l’éternité (2), La présence chrétienne dans l’Orient arabe entre le passé, le présent et l’avenir, Bethlehem, 2014, pp. 183-209 (en arabe).
21 « La présence chrétienne dans l’Orient arabe. Approche critique pour une présence renouvelée », in Pour des frontières ouvertes… (2), pp. 105-181 (en arabe).
22 « Pour une nouvelle évangélisation dans les Églises de l’Orient arabe », in Pour des frontières ouvertes… (2), pp. 243-322 (en arabe).
23 Voir R. Khoury, « L’inculturation de la foi chrétienne dans les Églises du monde arabe à la lumière de l’Incarnation, de la Rédemption et de la Glorification », in Pour des frontières ouvertes entre le temps et l’éternité (1), Vers une théologie incarnée dans le sol de nos pays, Bethlehem, 2014, pp. 197-222 (en arabe); G. Khoury, « La théologie de l’olivier enraciné dans le sol palestinien », in Arabes Chrétiens, pp. 213-259.
24 Cf. J. Mansur, « Die arabische Kultur als einigendes Element in den Ortskirchen », in: Zwischen Halbmond und Davidstern, pp. 175-191, dont l’édition arabe se trouve in: Actes de la Vème conférence du centre Al-Liqa du programme « Théologie et Église locale », Bethlehem, 1991, pp. 73-91; G. Khoury, « L’Église incarnée », « Le rôle de l’enlise dans la délimitation de l’identité palestinienne », tous deux in: Arabes Chrétiens, respectivement pp. 170-175, 191-200.
25 Cf. R. Khoury, « Églises ou confessions ?… Perspective d’avenir », in Pour des frontières ouvertes (1), pp. 109-126 (en arabe). Pour ce thème voir aussi, Elias Khalifeh, « Les raisons historiques, culturelles et psychologiques de l’appartenance confessionnelle dans notre Église d’Orient », la revue Al-Liqa, vol. X, n. 1 (1995), pp. 20-32 (en arabe). Sur le thème de l’Église, voir aussi les contributions mentionnées dans la note 15 et 16. On ne peut ici que mentionner la lettre pastorale des Patriarches catholiques d’Orient intitulé Mystère de l’Église (Noël, 1996).
26 A titre d’exemples, nous pouvons mentionner (parmi beaucoup d’autres): N. Ateek, Justice, and only Justice. A Palestinian Theology of Liberation, New York, 1989, surtout le 4ème chapitre intitulé « The Bible and Liberation: A Palestinian Perspective », pp. 74-114; M. Raheb, I am a Palestinian Christian, Fortress Press, Minneapolis, 1995, surtout la deuxième partie intitulée « On interpreting the Bible in the Israeli-Palestinian Context », pp. 53-111; M. Sabbah, Lire et vivre la Bible au pays de la Bible, Lettre pastorale, Paris, 1993 (l’original est en arabe); G. Khoury, The Intifada of Heaven and Earth, Nazareth, 1989; le centre Al-Liqa a consacré à ce thème de l’interprétation biblique la première conférence de son programme « Théologie et Église locale », dont le titres sont révélateurs: « La terre et le peuple dans l’Ancien Testament » (G. Saba), « Les interprétations politiques actuelles de l’Ancien Testament » (Y. Zaknoun, O. Rantisi), « Comment lire le Nouveau Testament » (M. Younan), « Lecture palestinienne du Nouveau Testament » (G. Khoury) (tous en arabe); R. Khoury, Palästinensisches Christentum – Erfahrungen und Perspektiven, Trier, 1993, surtout le 4ème chapitre intitulé « Israel in der Theologie christlicher Palästinenser », pp. 36-44.
27Challenging Christian Zionism. Theology, Politics and the Israel-Palestine Conflict, edited by N. Ateek, C. Duaybis and M. Tobin, London, 2005 (traduit en arabe). Nous relevons les contributions locales (les théologiens palestiniens et les étrangers résidents à Jérusalem) et qui ont un caractère théologique: N. Ateek, « Introduction: Challenging Christian Zionism », pp. 13-19; R. Khoury, « The Effects of Christian Zionism on Palestinian Christians », pp. 145-153; J. Kuttab, « Justice and Mercy: The Missing Ingredients in Christian Zionism », pp. 163-168; « Religion: Problem or potential for Transformation », pp. 237-243; M. Raheb, « The Third Kingdom », pp. 263-27; B. Awad, « The Promise of the Father »; P. Du Brul, SJ, « The Promise of the Land (Genesis 1: 1-3) », pp. 285-292.
28Challenging Empire. God, faithfulness and Resistance, edited by N. Ateek, C. Duaybis and M. Tobin, Sabeel Center, 2012. Nous y relevons les contributions de caractère théologique: M. Raheb, « Blessed are the Meek », pp. 51-55; N. Ateek, « Theology as a Tool of Empire », pp. 93-105; N. Ateek, « Sermon: Faithfulness to Christ, resistance to Empire », pp. 193-197.
29The Bible and the Palestine-Israel Conflict, edited by N. Ateek, C. Duaybis and T. Whitehead, Sabeel center, 2014. Nous y relevons: D. Neuhaus « Biblical Authority », pp. 49-52; Y. Katanasho, « The Occupation of the Bible », pp. 59-64; J. Zaru, « The Bible and Occupation of Palestine », pp. 79-83; Y. Katanasho, « The Land of Promise », pp. 85-89; P. Kaswalder, « The Land of the Promise », pp. 97-104; P. Du Brul, « Does the Bible Have a Future », pp. 105-111; J. Kuttab, « International Law and Religion », pp. 187-193.
30 N. Ateek, A Palestinian Christian Cry for Reconciliation, New York, 2008.
31 Id., pp. 58-150.
32 Id., pp. 51-66.
33 « The theology and Politics of Christian Zionism », ibid., pp. 78-91.
34 « Jonas, the First Palestinian Liberation Theologian »,ibid., pp. 67-77.
35 « Son of David or Suffering Servant », ibid., pp. 92-103.
36 « Samson, the First Suicide Bomber », ibid.,pp. 115-129.
37 « Daniel or Judas Maccabeus », ibid., pp. 130-139.
38 « Whose Jerusalem? », ibid., pp. 140-150.
39The Invention of History. A Century of Interplay between Theology and Politics in Palestine, edited by M. Raheb, Contextual Theology Series, Bethlehem, 2011. Nous relevons les titres suivants: M. Raheb, « Displacement Theopolitics. A Century of Interplay between Theology and Politics in Palestine », pp. 9-32; P. N. Tarazi, « Hermeneutical Shifts vis-à-vis Palestine in the Twentieth Century: Romans 9-11 », pp. 167-184; J. Khader « Towards a New Theological Understanding vis-à-vis Palestine in the 21st Century, pp. 211-214; R. Khoury, « The Conflict of Narratives. From memory to Prophecy », pp. 259-268.
40The Biblical Text in the Context of Occupation. Towards a new hermeneutics of liberation, edited by M. Raheb, Contextual Theology Series, Bethlehem, 2012, dont nous relevons les contributions suivantes: M. Raheb, « Toward a New Hermeneutics of Liberation. A Palestinian Christian Perspective »; I. Munther, « Arab Christian Fundamentalist Reading of the Book of Daniel. A Critique », pp. 247-265; J. Khader, « Biblical Hermeneutics in the Kairos Palestine Document », pp. 267-280; R. Khoury, « The Context of the Christians of the Arab World as a Key to Biblical Interpretation According to the Six First pastoral Letters of the Eastern Catholic Patriarchs », pp. 281-295.
41 M. Raheb, Faith in the Face of Empire. The Bible through Palestinian Eyes, Bethlehem, 2014.
42 Cf. « L’interprétation biblique dans le christianisme ». Un regard global », in Pour des frontières ouvertes (1), pp. 401-419.
43 Cet article a paru d’abord en allemand: R. Khoury, « Die theologischen Implikationen der aktuellen Situation im Heiligen Land. Aus der Sicht eines christlichen Palästinensers », in Zwischen Halbmond une Davidstern, pp. 139-159. Cet article a été traduit en anglais et publié sous le titre « The Theological Implications of the Current Situation in the Holy Land: From the view of a Christian Palestinian, in An Erdmans Reader in Contemporary Political Theology, edited by W. T. Cavanaugh, J. W. Bailey, C. Hovey, Cambridge (United Kingdom), 2012, pp. 566-584, tandis que la version arabe de cet article se trouve in Pour des frontières ouvertes(1), pp. 221-452.
44 « Le peuple palestinien comme lieu théologique », in Dis ta parole et passe! Préambules rapides à des dossiers vitaux, Al-Liqa, 2002, pp. 18-25 (en arabe). Cf. aussi R. Khoury, « The Palestinian People as a theological Issue », internet http://groups.creighton.edu/sjdialogue/documents/articles/jesuit_jewish_dialogue_02.html.
45 « La Parole de Dieu dans la communauté chrétienne selon les lettres Pastorales des patriarches catholiques », in Pour des frontières ouvertes… (1), pp. 127-152 (en arabe).
46 Cf., A. Rantisi, « Gegenwärtige politische Interpretationen des Alten Testamentes », in Zwischen Halbmond une Davidstern, pp. 102-107.
47 M. Younan, « Die Landfrage aus einer christlichen Perspektive », in Zwischen Halbmond und Davidstern, pp. 108-120. Cf. aussi: M. Sabbah, « Terra Promessa » in Voce che grida dal deserto, A cura di N. Capovilla, Milano, 2008 pp. 29-44 (ce livre est aussi traduit en arabe); N. Ateek, « Land of Promise: How do we understand the promise of the land? », in The Bible and the Palestine Israel Conflict, pp. 123-135; N. Ateek, The Bible and the Land », in A Palestinian Christian Cry, pp. 51-66. On peut signaler ici une œuvre importante sur la terre: A. Marchadour et D. Neuhaus, La terre, la Bible et l’histoire, Paris, 2006. Cf. aussi Pietro A. Kaswalder, La Terra della promessa. Elementi di geografia biblica, Gerusalemme, 2010.
48 Cf., Y. Katanasho, N. Cardosp Pereira, P. Kaswalder, « The Land of promise », in The Bible and the Palestine Israel Conflict, pp.85-104.Cf. aussi: Divine Promises to the Fathers in the Three Monotheistic Religions, Proceedings of a Symposium held in Jerusalem (1993), edited by Alviero Niccaci, Jerusalem, 1995.
49 Si les théologiens palestiniens se sont tournés surtout vers la Bible, il s’en trouve qui se sont tournés vers les icônes: Cf., à ce sujet, R. Khoury, « Le mystère de la Sainte Trinité, un projet divin pour le monde de l’Homme. Méditation en l’icône de la Sainte Trinité dans le contexte du monde arabe et de ses Églises », in Pour des frontières ouvertes, pp. 286-326; cet article a été traduit en allemand sous le titre Trinität. Dreifaltigkeit im Kontext der arabischen Welt und ihrer Kirchen, Berlin, 2014. Cf. aussi Gianazza P. G., « Les icônes arabes en général et palestiniennes en particulier », Al-Liqa, vol. XXIX, n. 4, 2014, pp. 95-116.
50God’s Reign and people’s Rule. Constitution, Religion, and Identity in Palestine, edited by M. Raheb, Berlin, 2009. Les contributions sont de caractère sociopolitique plutôt que théologique, mais on peut relever les contributions suivantes: R. Khoury, « Earthly and heavenly Kingdom: An Eastern Christian perspective », pp.87-93; V. Raheb, « Shifting bounderies of the self – Reflections from the perspective of the Diaspora », pp. 101-104; M. Raheb, « Postlude », pp. 151-157.
51Religion et État, édité par M. Raheb, Bethléem, 2011 (en arabe). Nous nous contentons de relever l’importante introduction à ce volume écrit par M. Raheb, qui situe le problème dans le cadre du monde arabe et du contexte palestinien, pp. 6-13.
52Projet national Palestinien et l’Etat moderne, Actes de la 25ème conférence du Patrimoine arabe, chrétien et musulman, en Terre Sainte (Septembre, 2013), revue Al-Liqa, Vol. XXIX, n. 1-2/2014. La contribution de R. Khoury porte le titre « L’Etat Palestinien attendu: perspective chrétienne », pp. 111-125 (en arabe).
53Religion and State. From Theocracy to Secularism, and in Between, Department of Religious Studies – Bethlehem University, edited by I. Twal and K. Malak, Bethlehem, 2013.Nous pouvons relever la contribution de M. Sabbah sous le titre « Religion and State in Palestine », pp. 10-17.
54 Sur ce sujet, il faut se référer à la deuxième Lettre Pastorale des patriarches catholiques d’Orient, Présence chrétienne en Orient: Mission et témoignage, 1992.
55 M. Sabbah, « Palästina, die Christen und der Friede », in Zwischen Halbmond und Davidstern, pp. 196-205; N. Ateek, « What the Bible Teaches about Peace », in Seeking and Pursuing Peace. The Process, the Pain and the Product, edited by S. Munayer, Jerusalem 1998, pp. 51-57; S. Munayer, « What is Peace? », in ibid; p. 67-72. .
56 Cf., J. Kuttab, « Bemerkungen zum zeitgenössischen palästinensischen Verständnis von Frieden und Gerechtigkeit », in Zwischen Halbmond und Davidstern, pp. 131-138.
57 N. Ateek, Justice and only Justice. A Palestinian Theology of Liberation, New York, 1989; cf. surtout pp. 100-150.
58Id., pp. 138-162.
59 N. Ateek, A Palestinian Christian Cry for Reconciliation, New York, 2008.
60 Cf., surtout pp. 153-187.
61 The Jerusalem Sabeel Document, Principles for a Just Peace in Palestine-Israel, Jerusalem, 2004.
62 M. Sabbah, Paix sur Jérusalem. Propos d’un évêque palestinien, propos rassemblés par Yves Teyssier d’Orfeuil, Paris, 2002; cf. surtout pp. 203-234.
63 Patriarch Michel Sabbah, Faithful Witness. On reconciliation and Peace in the Holy Land, edited and with an Introduction by D. Christiansen, S.J. and S. Sarsar, New York, 2009. Voir, à titre d’exemples, le chapitre 16ème intitulé « Freedom for Palestine and the Palestinians », pp. 147-149, et le chapitre 18ème intitulé « Peace, Justice and Forgiveness », pp. 155-164. On peut se référer aussi à un autre livre de textes choisis publiés en italien: Michel Sabbah, Patriarca latino di Gerusalemme, Voce che grida dal deserto.
64 M. Younan, Witnessing for Peace in Jerusalem and the World, Minneapolis (U.S.A.), 2003.
65 Cf. Les index de la revue Al-Liqa (1985-2010), le centre Al-Liqa, 2011 (en arabe).
66A moment of Truth. A word of faith, hope and love from the heart of Palestinian suffering. Kairos Palestine, Bethlehem, 2009 (en arabe et en anglais). Nous rappelons que ce texte est traduit en beaucoup d’autres langues.
67 Au sujet de ce document, voir, entre autres, R. Kassis, Kairos for Palestine, Ramallah, 2011; A.A.V.V. Karios for Global Justice, Bethlehem, 2011, en plus d’autres publications qu’on peut trouver sur le site www.Kairospalestine.ps.
68 Cf. J. Khader, « Biblical Hermeneutics in the Kairos Palestine Document », in The Biblical Text in the Context of Occupation, pp. 267-280.
69 Cf. Paix sur Jérusalem, pp. 213.
70 Voir N. Karmi, « An Introduction to the Kairos Palestine Document: a Tool for Non-violent resistance », in Violence, Non-Violence and Religion, Third International Conference on Christian-Muslim Relations, Conference Proceedings, Bethlehem University, 2011, pp. 223-227.
71 Centre Al-Liqa et Centre Sabeel, La résistance non-violente dans l’Islam et dans le Christianisme, Jérusalem, 2014 (en arabe).
72 La contribution chrétienne fondamentale à cette conférence, est celle du Patriarche M. Sabbah, « La résistance pacifique en Palestine. Une vision palestinienne chrétienne autour de la résistance pacifique », ibid., pp. 8-26. La contribution musulmane est celle de Sheikh Zouhair al-Dib’i (activiste non-violent musulman), « La non-violence et l’Islam », Ibid., pp. 27-65. Cf. aussi, M. Sabbah, « Con la nonviolenza si può », in Voce che grida, pp. 115-121. Dans ce cadre, on peut mentionner les prises de position claire du centre Sabeel, pour ce qui est des bombes-suicides: N. Ateek, Suicide Bombers. What is theologically and morally wrong with suicide bombings? A Palestinian Christian Perspective, Sabeel Documents, 2003, et aussi A Call For Morally Responsible Investment. A Nonviolent Response to the Occupation, Sabeel Documents, 2005.
73 Voir site www.kairospalestine.ps
74 Cf. La revue Al-Liqa, « Dossier: Où va la présence chrétienne? », Vol. XIX, n. 1-2, 2004, pp. 7-86 (en arabe). Nous y relevons les contributions suivantes: B. Sabella, « La présence chrétienne entre la crise d’identité et la volonté d’appartenance », pp. 25-32; J. Khader, « La présence chrétienne dans le monde politique », pp. 33-47, les autres articles étant de caractère socio-culturel et économique.
75 Cf. La revue Al-Liqa, « Dossier : L’Église de Galilée aujourd’hui entre le passé et l’avenir », vol. XX, n. 1-2, 2005, pp. 14-146 (en arabe). Le dossier comprend des articles de R. Khoury, B. Sabella, L. Hazboun, J. Mansour, H. Khoury et autres, qui traitent des divers aspects de la présence chrétienne en Galilée.
76 Cf La revue Al-Liqa, vol. XXV, n. 3-4, 2010, pp. 23-233 (en arabe). Les conférences ont été présentées surtout par des chrétiens de Galilée.
77 Cf. La revue Al-Liqa, « Dossier: Les arabes chrétiens en Terre Sainte: identité et appartenance », vol. XXI, n. 3-4, 2006, pp. 16-145, qui comprend des contributions de R. Khoury, Y. Matar, J. Mansour, Z. Shlewet, parmi beaucoup d’autres (en arabe).
78 Cf. La revue Al-Liqa, « Dossier: de l’Identité de foi à une présence effective », vol. XXVII, n. 3, 2012, pp. 35-138 (en arabe).
79 Ibid., pp. 43-66.
80 Ibid., pp. 67-74
81 Ibid., pp. 75-85 et 118-125.
82 Ibid., pp. 109-117 et 126-132.
83 Cf., La revue Al-Liqa, « Dossier: Libération… Libération de… Libération pour… », vol. XXVIII, n. 4, 2013, pp. 14-119 (en arabe).
84 « Le Christ nous libère », ibid., pp. 18-24.
85 « Libération du chrétien de ses chaînes intérieures » (complexe de minorité, le recours à l’étranger, le complexe de dhimmitude, formalisme…) ,ibid., pp. 25-60.
86 « L’égocentrisme: ses motifs, ses manifestations, ses conséquences », ibid., pp. 61-77.
87 « Dossier: Le Patrimoine Arabe Chrétien », la revue Al-Liqa, vol. IIème, n. 3, 1996, pp. 17-131 (en arabe).
88 On peut ajouter ici aussi qu’une collection de livrets, lancée en Terre Sainte sous le nom de Porte de la foi, a publié une série de textes de ce patrimoine, réalisés par le G. M. Gianazza, un grand spécialiste de ce patrimoine en Terre Sainte.
89 La visite de Jean-Paul II, la revue Al-Liqa, vol. XVème, n. 1-2, 2000 (en arabe); celle de Benoit XVI, la revue Al-Liqa, vol. XIV, n. 2-3, 2009 (en arabe); celle du pape François, vol. XXIX, n. 3, 2014 (ce même numéro comprend aussi une lecture rétroactive de Paul VI en 1964) (en arabe). Dans ces numéros ont été publiés tous les discours de cette occasion, comme aussi des lectures de ces visites pour en souligner l’importance pour les chrétiens palestiniens.
90 G. Khoury, Arabes Chrétiens: Authenticité, Présence, Ouverture, Bethlehem, 2006 (en arabe).
91 R. Khoury, Pour des frontières ouvertes entre le temps et l’éternité (2), La présence chrétienne dans l’Orient arabe entre le passé, le présent et l’avenir, Bethlehem, 2014 (en arabe).
92 « La présence chrétienne dans l’Orient Arabe: parcours historique global », ibid., pp. 25-103.
93 « La présence chrétienne dans l’Orient Arabe: Approche critique pour une présence renouvelée », ibid., pp. 105-181.
94 Cf. l’ouvrage cité plus haut (note n. 90), « Arabes chrétiens: traducteurs, commentateurs, auteurs », « La foi et la raison dans le Patrimoine Arabe Chrétien », « l’Évangile dans la philosophie des arabes et dans leur théologie », « La Morale dans le Patrimoine Arabe Chrétien », respectivement pp. 21-24, 25-44, 45-64, 65-81.
95« Les défis actuels qu’affrontent la présence et le témoignage des chrétiens dans l’Orient Arabe », ibid., pp. 183-209.
96 « La présence chrétienne dans l’Orient Arabe dans le contexte des ‘révolutions’ arabes », ibid., pp. 211-240.
97 « Le chrétien palestinien et les défis historiques », « L’Église locale et les défis politiques », « L’Église locale et le problème palestinien depuis 1967 », respectivement pp. 85-95, 97-107, 109-123.
98 « Pour une nouvelle évangélisation dans les Églises de l’Orient Arabe », ibid., pp. 243-322.
99 « Une question qui nous provoque et une réponse qui nous attend », ibid., pp. 373-405.
100 « Tradition et traditions dans les Églises d’Orient : Approche critique », ibid., pp. 407-430.
101 « L’Eglise incarnée », « Le rôle de l’Eglise pour définir l’identité chrétienne », in Arabes chrétiens, pp. 169-175 et 191-200; voir aussi R. Khoury, « La référence arabe du christianisme en Orient », in Pour des frontières ouvertes (2), pp. 433-460.
102 Sixth International Conference, The Forgotten Faithful. A Window into the Life and Witness of Christians in the Holy Land, edited by N. Ateek, C. Duaybis and M. Tobin, Sabeel, 2007 (les actes de cette conférence existent aussi en arabe).
103 M. Raheb, Sailing Through Troubled Waters. Christianity in the Middle East, Bethlehem, 2013.Il a aussi publié en arabe certains de ses articles antérieurs, publiés surtout dans la revue Al-Liqa entre 1989 et 2013 sous le titre Les chrétiens arabes et les problèmes de la nation. Changements du contexte et des rôles, Bethléem, 2013, où il traite de plusieurs aspects de cette présence (l’Église et le pouvoir politique, concept de la justice et de la paix dans la pensée chrétienne actuelle, l’émigration, les révolutions actuelles…). A ces livres, on peut ajouter aussi la publication de ses homélies pendant ses 25 ans de ministère, en arabe et en allemand. L’édition arabe porte le titre de Parole en Situation, Homélies d’un quart de siècle (1988-2013), Bethléem, 2013. La traduction allemande de ces homélies a été publié par Aphorisma (Allemagne) sous le titre Christ-Sein in der arabischen Welt. 25 Jahre Dienst in Bethlehem, Berlin, 2013.
104 M. Younan, Witnessing for Peace in Jerusalem and the World, Minneapolis (USA, 2003) et Our Shared Witness. A Voice for Justice and Reconciliation, Minneapolis (USA), 2012.
105 Cf., R. Khoury, « Le Mystère de la Sainte Trinité, un projet divin pour le monde de l’homme. Méditation sur l’icône de la Sainte Trinité dans le contexte du monde arabe et de ses Eglises », in Pour des frontières ouvertes (1), pp. 286-326, surtout les pages 300-303, 310-313, 320-325.
106 Cf., R. Khoury, « Le dialogue dans le christianisme selon les lettres pastorales des Patriarches catholiques d’Orient », dans la revue Al-Liqa, vol. XXIII, n. 2, 2008, pp. 67-79.
107 « Dossier: Le dialogue ou la mort », dans lequel nous trouvons, en plus de l’article mentionné dans la note précédente, un article sur le dialogue en islam (Abdel Ruhman Abbad, le dialogue dans le Saint Coran, pp. 19-66) (en arabe). Par ailleurs, le centre Al-Liqa a publié un livre du même auteur sur le dialogue dans l’Islam (Bethlehem 2010) (en arabe).
108 « Dossier: Du dialogue des cultures à la culture de dialogue », dans la revue Al-Liqa, vol. XVI, n. 3, 2001, pp. 22-96 (voir surtout l’introduction à ce dossier, pp. 22-32) (en arabe).
109 R. Khoury, « L’identité: Sens. Eléments. Dimensions », Al-Liqa, vol. XXI, n. 3-4, 2006, pp. 20-39 (en arabe); cf aussi dans une perspective de diaspora: V. Raheb, « Shifting boundaries of the self. Reflections from the perspective of the Diaspora », in God’s Reign and people’s Rule, pp. 101-104; cf. aussi: Id., Nächstes Jahr in Bethlehem. Notizen aus der Diaspora, Berlin 2008 (http://www.violaraheb.net/downloads/Vorwort%20N%C3%A4chstes%20Jahr%20in%20Bethlehem.pdf)
110 Cf., « Die Zukunft der Kirche zwischen Einheit und Vielhaft », in Zwischen Halbmond und Davidstern, pp. 225-235.
111 Cf., F. Bouwen, « La revue Al-Liqa et les relations œcuménique, dans la revue Al-Liqa, col. XXVI, n. 1-2, 2011, pp. 85-92 (en arabe).
112 Le premier dossier remonte loin (1994) et réunit les quatre documents issus du dialogue entre l’Eglise orthodoxe et l’Église catholique: Cf. « Dossier: Le dialogue théologique entre l’Église orthodoxe et catholique. Textes et commentaires », vol. IX, n. 3, 1993, pp. 16-129 (en arabe). Le deuxième dossier est plus récent (2004) et réunit les documents œcuméniqueentre les Églises orthodoxes orientales et l’Église catholique, comme aussi ceux entre les Eglises orientales elles-mêmes, avec des commentaires appropriés: Cf., « Dossier: Signes sur le chemin de l’unité chrétienne en Orient: Documents œcuméniques », vol. XIX, n. 3-4, 2004, pp. 17-139 (en arabe). A ces textes, on peut ajouter un texte plus récent publié par la revue Al-Liqa, le document issu du dialogue entre l’Église catholique et les Églises orthodoxes orientales: Commission internationale mixte de dialogue théologique entre l’Eglise catholique et les Églises orthodoxes orientales, Nature, structure et missionarité de l’Église, vol., XVIII, n. 1, 2013, pp. 148-168 (en arabe). On peut ajouter ici une étude sur les horizons œcuméniques du Patrimoine Arabe Chrétien: Cf. R. Khoury, « Les horizons œcuméniques dans le Patrimoine Arabe Chrétien », Al-Liqa, vol. XXX, n. 1, 2015, pp. 61-89.
113 Cf., M. Younan, La dimension œcuménique de l’activité du Patriarche Michel Sabbah, in Al-Liqa, vol. XX, n. 3-4, 2005, pp. 25-30 (en arabe). M. Sabbah, « Le dialogue entre Églises », in Paix sur Jérusalem, pp. 121-152; M. Younan, « Ecumenism is Reconciliation in the Middle East and in the World », in Our Shared Witness, pp. 111.
114 « Musulmans et chrétiens ensemble; Passé, présent et avenir », dans la revue Al-Liqa, vol. XVI, n. 4, 2001, pp. 18-94 (en arabe).
115 « Construction de la confiance entre le monde arabe et musulman et l’Occident », dans la revue Al-Liqa, vol. XXV, n. 1-2, 2010, pp. 4-352 (en arabe).
116 « Entre l’Orient et l’Occident. Vers un discours modéré et universel », Al-Liqa, vol. XXVII, n. 2, 2012, pp. 11-121 (en arabe).
117 « Où vont les révolutions arabes », Al-Liqa, vol. XXVII, n. 4, 2012, pp. 14-160 (en arabe).
118 Encore et encore… Les révolutions arabes », Al-Liqa, vol. XXVIII, n. 2-3 , 2013, pp. 7-212 (en arabe). Il est à remarquer que, dans ces conférences sur les révolutions arabes, les conséquences de ces révolutions sur les relations islamo-chrétiennes, ont toujours été étudiées.
119 G. Khoury, Arabes chrétiens et musulmans; Passé… Présent… Avenir, Bethlehem 2006 (en arabe).
120 G. Khoury, Le livre de la preuve pour affirmer la foi. Sophrone, Patriarche de Jérusalem: Sa vie, ses œuvres,la Charte d’Omar, Bethlehem 2015, 494 pages (en arabe).
121Bethlehem University International Religious Conference, Living Together Peacefully. The Experience of Christian-Muslim Co-existence in the Middle East, Europe, USA and Philippines, Bethlehem 2007.
122 Bethlehem University, The Influence of Education and Media on Christian-Muslim Relations, 2nd International Religious Conference, Bethlehem 2008.
123 Bethlehem University – Department of Religious Studies, Violence, Non-Violence and Religion, edited by J. Khader, A. Hawash-Abu Eita, Bethlehem University, 2011. Parmi les diverses interventions, on peut relever celle de D. Neuhaus sur l’usage de la Bible pour justifier la violence (« The Use of the Bible to Justify Violence », pp. 141-146).
124 J. Khader et B. Fawzi al-Qasrawi, The Principles of Dialogue among Religions in Light of Conflicts – Palestine as a Model, in First International Islamic Christian Conference, Bethlehem, 2010, in English and Arabic, pp. 40-85.
125 L’édition anglaise de cet essai se trouve dans : Al-Liqa’ Journal, « Engaging with the Holy Qur’an, vol. 39, Dec. 2012, pp. 93-128, tandis que l’édition arabe (de 48 pages) a été publié dans un livret à part à Bethléem par le Comité Episcopal des Institutions Éducatives Chrétienne (Bethléem, 2014). Cf. aussi, M. Raheb, « Contextualizing the Scripture: Towards a New Understanding of the Qur’an. An Arab Christian Perspective », in Sailing through Troubled Waters, pp.49-76. Dans ce context, cf. C. Van Nispen, « The Encounter between Muslims and Christians: Some Reflections on Spiritual Solidarity », in Living Together Peacefully?, pp. 200-205. Il faut y ajouter la contribution immense, sur le plan théorique et pratique du patriarche Michel Sabbah: cf., sur ce sujet, M. Sabbah, « Chrétiens, aimez vos frères musulmans », in Paix sur Jérusalem, pp. 153-174.
126 Cf., entre autres, B. F. Qasrawi, « The Other in the Islamic Religious Education textbooks », et I. Nairouz, « The other in the Christian Religious Education Curriculum » tous deux in The influence of Education and Media on Christian-Muslim Relations, pp.20-35. Cf. aussi J. Khader, « teaching Christianity to Christian and Muslim Student », in Living Together peacefully?, pp. 50-52. Aussi G. Khoury, Le rôle de l’éducation religieuse dans l’affirmation de l’unité nationale », in Arabes chrétiens et musulmans, pp. 167-189 (en arabe); cf. aussi R. Khoury, « Le discours religieux et le rôle des institutions religieuses », Al-Liqa, vol. XVI, n. 4, 2001, pp. 49-63 (en arabe).
127 Cf., entre autres, P. Du Brul, « For Whom the Bell Tolls: Reflections on the Media’s Distortions of religious Issue », in The influence of Education and Media on Christian-Muslim Relations, pp. 139-147.
128 L. Kelman, Le rôle du Rabbin dans la tradition juive », dans la revue Al-Liqa, vol. XVIII, n. 1-2-3, 2003, pp. 85-93 (en arabe).
129 J. Malgrom, « L’importance de Jérusalem dans la religion juive », dans la revue al-Liqa, vol. V, n. é, 1990, pp. 21-29 (en arabe). Dans ce cadre, on peut mentionner: D. Neuhaus, « Lettre ouverte à un Sheikh, un prêtre et un Rabbin », dans la revue Al-Liqa, vol. XVIII, n. 1-2-3, 2003, pp. 108-120 (en arabe).
130 M. Younan, « Principles for Witness in Theological Trialogue”, in Witnessing for Peace in Jerusalem and the World, pp. 120-162; cf. aussi Id., « Bring Religion back to the Front Lines of Peace », and Id. « The Role of Religion in the Middle East », in Our Shared Witness, pp. 141-143 et pp. 144-149.
131 A. Shinan, M. Lahham, M. Abu Sway, Abraham in the Monotheistic Faiths, 1999; I. Abu Salem, J. Milgrom, D; Neuhaus, Joseph in the Three Monotheistic Faiths, Jerusalem 2002; D. Rosen, L. Hazboun, M. Abu Sway, Moses in the Three Monotheistic Faiths, Jerusalem 2003; R. Khoury, M. Abu Sway, Jesus in the Christian and Muslim Faiths, Jerusalem 2007; A.A.V.V., Dialogue on Jerusalem, edited by M. Abdul Hadi, Jerusalem 1998. Tous ces livres ont été publiés par Passia. Ce centre s’est intéressé aussi au dialogue islamo-chrétien. Voir, à titre d’exemple, Dialogue islamo-chrétien à Jérusalem. Série de rencontres et de dialogue, Jerusalem 2001 (en arabe).
132 J. Khader, « Paix et réconciliation. La religion pont ou obstacle ? », dans la revue Chemins de Dialogue, 34 (2009), pp. 53-67; « The Principles of Dialogue among Religions in Light of Conflicts – Palestine as a model », in First International Islamic Christian Conference, Jerusalem 2014, pp. 40-90; cf. aussi du même auteur, « The Religious Factor: an Opportunity for Co-existence or a Threat to Peace? », in Modernism and Post-Modernism: North-South Interaction, Reinterpretation, Future Prospects. Proceedings of the Frist Joint Conference between Bethlehem University and The Catholic University of Applied Sciences, Köln. 13-14 September 2005, ed. by H. Theisen, W.Mustafa, Bethlehem 2006, pp. 62-74., .
133 Cf. E. Chacour, « La mémoire n’est pas le privilège du peuple juif », in J’ai foi en nous. Au-delà du désespoir, Paris 2002, pp. 41-48.
134 Voir surtout le recueil poétique Pourquoi tu as laissé le cheval seul, London-Beirut-Cyprus 1995 (en arabe).
135 E. Chacour, Blood Brothers, Michigan (USA), 1984; We Belong to the Land, en collaboration avec M. Jensen, New York, 1990 et le dernier en date qui peut être joint à ce genre de livres, J’ai foi en nous. Au-delà du désespoir, Paris, 2002.
136 E. Shoufani, Le Curé de Nazareth, avec la collaboration de H. Prolongeau, Paris, 1998.
137 M. Raheb,« My Identity as a Palestinian Christian », in I am a Palestinian Christian, Minneapolis (USA) 1995, pp. 3-14; Betlehem Besieged. Stories of Hope in Times of Trouble, Minneapolis (USA), 2004.
138 V. Raheb, Nächstes Jahr in Bethlehem; Notizen aus der Diaspora.
139 M Younan, « ’We Have This Cloud of Witnesses: The Younan Family Story », in Witnessing for Peace, Minneapolis (USA), 2003, pp. 21-37.
140 R. Shehadeh, Strangers in the House. Coming of age in occupied Palestine, London, 2002; When the Bulbul stopped singing. A diary of Ramallah under siege, London, 2003.
141G. Khoury, « Cresere in Palestina », in Un Palestinese porta la sua croce, Bologna, 2009.
142 R. Kassis, « My Nakba and My Hope », in Kairos for Palestine, Ramallah, 2011.
143 Terra Sancta School for Girls, The Wall cannot stop our stories. Diaries from Palestine 2000-2004, edited by S. Atallah, T. van Teeffelen, Bethlehem, 2004. On peut ajouter aussi des livres d’images avec commentaires qui disent l’expérience palestinienne de la Nakba: Our Story. The Palestinians, edited by N. Attek and H. Rantisi, Sabeel center, Jerusalem, 1999; I come from there… and remember, Jerusalem, 2008. A cette littérature aussi, on peut joindre les livres de l’Evêque B. Mouallem, A la lumière de l’Heure, Beyrouth, 2008, A la Lumière des Olives de Galilée (sans lieu, 2009), A la Lumière des Evénements, sans lieu, 2011 ; A la lumière du Printemps, sans lieu, 2012 (tous en arabe). Ces livres sont des commentaires personnels sur les événements de la vie quotidienne en Galilée.
144 Cf. R. Khoury, « Les implications théologiques du conflit actuel en Palestine », in Pour des frontières ouvertes… (1), pp. 447-451 (en arabe).
145 « Mémoire: Vision de Jérusalem », Al-Liqa, vol. X, n. 1, 1995, pp. 132-140 (en arabe).
146 « A Jérusalem s’embrassent la paix et la justice » in Actes de la troisième conférence de « Théologie et Eglise Locale » (Juillet 1989), Publicaions Al-Liqa, Jérusalem, pp. 33-38 (en arabe). Voir aussi un dossier sur Jérusalem publié par la revue Al-Liqa, vol. V, n. 2, 1990, pp. 5-59 (en arabe). Voir aussi, les Actes d’une journée d’études organisée par le centre al-Liqa: Jerusalem. Between Religious Freedom and Political Sovereignty, Bethlehem, 1995.
147Jérusalem. Etudes palestiniennes, chrétiennes et musulmanes, édité par G. Khoury, A. Mousallam, M. Darwish, Bethlehem1996 (en arabe).
148 « Dossier: Jérusalem capitale de la culture arabe », vol. XXIV, n. 4, 2009, pp. 4-91. On peut y relever : R. Khoury, « Jérusalem dans la mémoire chrétienne », pp. 31-54; G. Khodr, « Jérusalem dans la conscience des chrétiens arabes », pp.55-60 (en arabe).
149 « Whose Jerusalem? », in A Palestinian Christian Cry, pp. 140-150, qui présente surtout un regard biblique sur Jérusalem; voir aussi dans le même volume pp. 172-175.
150 « Jerusalem Today and Tomorrow. Four Visions », in Our Shared Witness, pp. 112-123.
151 « Jérusalem dans le discours chrétien », in Les Chrétiens arabes et les questions de la nation, pp. 89-112 (en arabe).
152 « Die Vision eines neuen Jerusalem », in Nächstes Jahr, pp. 105-112.
153 « Jérusalem pour les Palestiniens chrétiens », in Arabes Chrétiens, pp. 123-136 (en arabe).
154 M. Sabbah, Paix sur Jérusalem, pp. 265-294; Faithful Witness, pp. 100-108; Voce che grida nel deserto, pp. 53-60. Tous ces ouvrages sur la pensée de Michel Sabbah rapportent sa contribution à la réflexion autour de Jérusalem à partir de ses réalités concrètes (« une ville, deux peuples, trois religions »).
155 Cf. R. Khoury, « La théologie en Palestine », in Pour des frontières ouvertes… (1), p. 283.
156 Cf., A. Fleyfel, La théologie contextuelle arabe. Modèle libanais, Paris, 2011, où il étudie, entre autres, l’œuvre des grands précurseurs, comme Youakim Moubarac et Michel Hayek (il est dommage que Jean Corbon, surtout avec son grand livre Eglise des Arabes n’y figure pas).
157 A notre connaissance, trois congrès ont été organisés dans ce sens: le premier en 2002 a eu pour sujet Pour une théologie arabe moderne, dont les Actes ont été publiés sous ce titre, le second en 2004 sous le titre Vers une terminologie théologique arabe unifiée, et le troisième en 2006 sous le titre Unicité et trinité en Dieu, tous publiés par le Séminaire de Ghazir (en arabe).
158 Les Actes de ce congrès ont été publiés à Beyrouth en 2008 et portent le titre de Quo Vadis, Theologia Orientalis? Actes du colloque « Théologie Orientale: contenu et importance » (Ain Traz, avril 2005). La plupart des contributions à ce congrès ont été traduits en arabe et publiés par la revue Al-Liqa dans deux numéros consécutifs sous le titre « Pour une théologie incarnée dans le monde arabe », Al-Liqa, vol., XXII, n. 2, 2007, pp.5-103 et vol. XXII, n. 3, 2007, pp. 5-85.
159 Voir Hexalogie pour des Temps Nouveaux. Les six premières Lettres Pastorales des Patriarches catholiques d’Orient, éditées et présentées par Rafiq Khoury, Jérusalem et Beyrouth, 2008. Plusieurs aspects de cette théologie ont été relevés par R. Khoury, entre autres: « Semences christologiques orientales dans les Lettres Pastorales d’Orient », in Pour des frontières ouvertes… (1), pp. 327-359 (en arabe). Voir aussi: F. Daou, « Les limites et les chances d’une théologie contextuelle dans les lettres pastorales des Patriarches catholiques d’Orient », in Quo Vadis, Theologia Orientalis?, pp. 81-92.
160Cf. R. Khoury, « Pour une Synthèse théologique moderne dans le monde arabe », in Pour des frontières ouvertes(1), pp. 505-527 (en arabe).
Jul 23 2015
Bibliographie éthiopienne
Cette bibliographie des œuvres éthiopiens qui traitent le christianisme et les églises en Ethiopie, leur littérature, les langues, l’histoire et leur engagement pastoral et social est compilée par le Centre Capucin pour la Recherche et la Retraite Spirituelle, Addis-Abeba, sous la direction de Br. Daniel Assefa OFMCap et mise à jour et complétée continuellement .
ፋንታሁን እንግዳ፣ ታሪካዊ መዝገበ-ሰበ፣ ከጥንት እስከ ዛሬ፤ አዲሰ አበባ፣ 2000 ዓ.ም
This is a Dictionary of biographies written by Fantahun Engeda and published in 2008. It includes the life of Ethiopian kings and leaders, heroes, politicians, artists, famous athletes and great personalities. The names of the persons are given according to the order of the Amharic alphabet and takes account of personalities from Antiquity up to the end of the 20th century.. The author warns the reader in his introduction that he has been obliged to be selective and explains the reasons for which it was not able to be more exhaustive. Yet, one finds in the work of 740 pages, with small fonts and tight space between words and lines, a remarkably high number of names and a considerable amount of information.
– ፈቃደ ሥላሴ ተፈራ (ሊቀ ጉባኤ)፣ ጥንታዊ የብራና መጻሕፍት አዘገጃጀት፤ 2002 ዓ.ም
A book on the preparation of Ethiopian manuscripts by Fekade Sellassie, published in 2010 in Addis Abeba. A thorough explanation is given of the various aspects of book making, divided in 14 chapters. The author dedicates many pages on paleography, the life of Ethiopian scribes, their training, their technique of preparing colors, ink, parchments and the art of binding.
– አለባቸው አደም (አዘጋጅ)፣ የአየር ንብረት ለውጥ፤ የአካባቢ ጥበቃና የዘላቂ ልት ትስስር በኢትዮጵያ፤ 2004 ዓ.ም
This is a collection of articles on the interaction of climate change, care of the environment and sustainable development in Ethiopia, edited by Alebachew Adem in 2012. It contains 6 articles by different authors: 1) Climate change in Ethiopia: symptoms, consequences and threats; 2) the relationship between climate change and poverty in Ethiopia; 3) Climate change and erosion in Ethiopia; 4) building the capacity of agriculture in order to resist to climate change; 5) Climate change, women and social health-care in Ethiopia; 6) Climate change, water and energy in Ethiopia.
– ተፈሪ መኰንን፤ ረዥሙ የሥልጣን ጉዞ በምኒልክ፣ በኢያሱና በውዲቱ ዘመን፤ 1884-1922
This book reprinted for the third time in 2007 is a study of Teferi Mekonnen’s life, from birth to adulthood, before he became Emperor Haile Sellassie. The author, Zewde Reta, explains how this could take place despite the fact that Teferi Mekonnen was not the direct heir of the Ethiopian throne. Based on various documents and reports of eyewitnesses, the book helps to clarify recent oral traditions and rumors concern Emperor Hailesselassie’s access to power.
– ዘውዴ ረታ፣ የኤርትራ ጉዳይ 1941-1963፣ 1992 ዓ.ም
Published for the first time in 2000, and reprinted five times since then, this book explains with great details and with rich historical documents all relevant issues concerning Eritrea from 1941 to 1963. The year 1941 marked the end of 5 years of Italian occupation in Ethiopia and the termination of 60 years of Italian Colony in Eritrea. The role played by Ethiopia, the U.S.A, Great Britain, the Soviet Union, France and several other countries concerning Eritrea has been discussed by Zewde Reta, a former journalist and Ambassador of Ethiopia to Italy. The author, had access to rare and hitherto unknown documents thanks to his proximity to Emperor Haile Selassie and key persons in the court of Ethiopia.
– በላይ መኰንን ሥዩም (ሊቀ ኀ.)፣ ሕያው ልሳን፣ ግእዝ-አማርኛ መዝገበ ቃላት፣ 2000 ዓ.ም
A Ge’ez- Amharic Dictionary by Belay Mekonnen, published in Addis Ababa, in 2008, on the occasion of “Ethiopian” entrance into the Third Millennium. The dictionary offers over 10, 000 entries. An attempt to make the classical language accessible to modern readers is visible in the various usages of a given word illustrated by sentences from modern social life. The expression “a living language” in the title indicates the concern to show the importance of Ge’ez.
– በላይ መኰንን ሥዩም (ሊቀ ኀ.)፣ ትንሣኤ፤ አማርኛ – ግእዝ መዝገበ ቃላት፣ 2009 ዓ.ም
An Amharic-Ge’ez Dictionary, with more than 15, 000 words, by Belay Mekonnen, published in Addis Ababa, in 2009 by the same author of A Ge’ez-Amharic Dictionary. This time, term “resurrection” is included in the Title. This work seems to be the first in its kind. The author has tried to give new Ge’ez words for modern Amharic terms inexistent in in Ge’ez.
– ዳንኤል ክብረት፣ የቤተ ክርስቲያን መረጃዎች፣ አዲስ አበባ፣ 1999 ዓ.ም.
A book of detailed historical and geographical information on Ethiopian Churches and monasteries (over 500 hundred), biographies of religious people and relevant ecclesiastical personalities. It is written in Amharic by Daniel Kebret and published in 2007. The entries follow an alphabetical order.
– ፋንታሁን እንግዳ፣ ሥነ- ፅሁፋዊ- ሙዳዬ ቃላት፣ ከነማብራሪያቸው፣ 2003 ዓ.ም.
This is a dictionary of literary terms in Amharic by Fantahun Engeda, published in 2011, in Addis Ababa. The entries are taken from oral literature, fiction, poetry, essays, theatre, literary critique, and literary genres and the various elements of the art of narration. While the Amharic alphabetical order is followed, the author gives an English equivalent word at the end of the presentation of a given entry.
– ኤልያስ ነቢየ ልዑል (አለቃ)፣ ከፍያለው መራሐ (ቀሲስ)፣ ትርጓሜ ቅኔ ፈለገ ሕይወት፣ 1992 ዓ.ም.
This book by Elias Nebiya Le’ul and Kefylew Merahi, published in 2000, presents various types of Ge’ez poems (Qenie) with their Amharic translation, their interpretation and a substantial description of the historical context in which the poem has been composed. Biographical data concerning the author of the poem is also given.
– ምሥራቅ ጥዩ (አባ)፣ ነቢይ ማን ነው? ዐሥራ ስስቱ ታላላቅና ታናናሽ ነቢያቶች፣ 2005 ዓ.ም.
An exegetical presentation of prophets of the Old Testament by Misrak Tiyo, published in 2013. After two preliminary chapters dedicated to the socio-historical background of the prophets, the book presents each book of the Old Testament prophets. Besides issues of content and form, the author discusses each prophet’s relevance in the Context of the New Testament.
– ዳኛቸው ወርቁ፣ አደፍርስ፣ አዲስ አበባ፣ ግራፊክ፣ 2007 ዓ.ም. (ድጋሚ)
A second edition of the novel entitled “Adafres”, written by Dagnachew Worku, published by Addis Ababa, 2015. The first edition was published in 1970. This is one of the most difficult and original Amharic novels. One has to read it several times in order to appreciate the plot, the rich Amharic vocabulary and the innovative style.
– እጓለ ገብረ ዮሐንስ፣ የከፍተኛ ትምህርት ዘይቤ፣ አዲስ አበባ፣ አርቲስቲክ፣ 2003 ዓ.ም. (ሁለተኛ ዕትም)
Egwala Gebra Yohannes, The method of Higher Study, Addis Ababa, in 2011. This is also a second edition of a book originally published in 1962. It is a reflection on the need of integrating Western Knowledge with Ethiopian traditional knowledge. The author, who has the background of traditional Ethiopian wisdom and studied western philosophy in Western Europe, underlines that higher education in Ethiopia will not succeed unless one incorporates the two traditions.
– መጋቤ ሐዲስ ሮዳስ ታደሰ፣ ነገረ ማርያም በሐዲስ ኪዳን፣ አዲስ አበባ፣ 2007 ዓ.ም. Rodas Tadesse, Mariology in the New Testament, 2015.
Based on Traditional Ethiopian theology, the book explains the role of Mary in the New Testament. Almost all the references to Mary in the Gospels and other parts of the New Testament are discussed.
– መጋቤ ሐዲስ ሮዳስ ታደሰ፣ ነገረ ማርያም በሊቃውንት፣ ክፍል አንድ፣ 2007 ዓ.ም.
Rodas Tadesse, Mariology among the Church Fathers, Part I, 2015. In this book, the author who explained the role of Mary in the New Testament does the same for the period that concerns and follows the era of the Apostles. It covers the fathers of the first four centuries.
– ገድለ አቡነ እስጢፋኖስ ዘጕንዳጕንዶ፣ 1996 ዓ.ም.
The Acts of Abuna Estifanos of Gunda Gundo, published in 2004. It describes in Ge’ez with an Amharic translation (second column) the life of the founder of a monastic movement persecuted in the 15th century. He advocated ascetic life, poverty and autonomy with regard to secular power. He faced much opposition, and, together with his followers, underwent much persecution accused of heresy.
– ብርሃኑ ገ/ፃድቅ፣ የአማርኛ ፈሊጣዊ አነጋገሮች እና ፍቺዎቻቸው፤ አዲስ አበባ፣ 1993 ዓ.ም.
This is a collection of Amharic idiomatic expressions and their explanation by Berhanu GebreTsadiq, published in Addis Ababa in 2001 (312 pages). It is easy to make a search for the expressions for they are presented according to the Amharic alphabetical order. There are also about 1200 exercises whereby the reader is invited to match a given expression with the corresponding explanation or expression. The keys to the exercises are given at the end of the book.
– ብርሃኑ ገ/ፃድቅ፣ ምርጥ የአማርኛ ምሳሌያዊ አነጋገሮች ስብስብ፤ 8500 ምሳሌያዊ አነጋገሮች፣ አዲስ አበባ፣ 1998 ዓ.ም.
A collection of 8500 Amharic proverbial expressions, by Berhanu GebreTsadiq, published in Addis Ababa in 2007. The proverbs are presented according to the Amharic alphabetical order. Explanations are however not given after each proverb. There is a glossary of difficult Amharic terms at the end of the book.
– ደበበ ኃይለ ጊዮርጊስ፣ የአማርኛ ፈሊጣዊ አነጋገሮች ከፍቺዎቻቸውና ከትክክለኛ አገባባቸው ጋር፤ አዲስ አበባ፣ 1996 ዓ.ም.
A collection of over 1500 Amharic idiomatic expressions and their explanation by Debebe Haileghiorghis, published in Addis Ababa in 2002 (404 pages). At each entry, one finds the idiom in alphabetical order, its explanations and a sentence that shows how the idiom is used in Amharic. The examples are valuable indeed for they show the usage of the idioms. Exercises are also included with their keys.
– ደበበ ኃይለ ጊዮርጊስ፣ የምሳሌያዊ አነጋገሮች መጽሐፍ፣ ከአቻ ምሳሌያዊ አነጋገሮችና ከምስጥራዊ ፍቺዎቻቸው ጋር የቀረበ ልዩ ዝግጅት፤ አዲስ አበባ፣ 1999 ዓ.ም.
A collection of Amharic proverbs in alphabetical, by Debebe Haileghiorghis, published in Addis Ababa in 2005 (475 pages). Each proverb, whenever available, is followed by one or more equivalent proverbs and an explanation. Exercises and keys are provided. At the end of the book, one finds a glossary of difficult Amharic terms.
– ታደለ ገድሌ፣ ቅኔ እና ቅኔያዊ ጨዋታ ለትዝታ፣ አዲስ አበባ፣ 1995 ዓ.ም.
An explanation of Qəne (a genre of Ge’ez literature) and humoristic short stories by Tadele Gadle, published in 2003 (162 pages). The first section is dedicated to the meaning pf Qəne, its background and its significance. The author has also added historical humoristic stories supposed to have happened in during the traditional schools of Qǝne or that caused the composition of some Qənes. In the second section humoristic and satirical memoirs are narrated.
– አክሊሉ ታደለ፣ ክህነትና ካህን በቤቱ በዕሥራ ምእት (2000 ዓ.ም.)፤ አዲስ አበባ፣ 1999 ዓ.ም.
This is a treatise of Christian priesthood from the perspective of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, by Aklilu Tadele, published in 2007, in Addis Ababa (174 pages). It has three parts. The first part deals with priesthood in general. The second focuses on Priesthood in Ethiopia. The third discusses pastoral and moral issues supposed to be respected by the priest.
– ጳውሎስ ኞኞ፣ አጤ ምኒልክ፣ በሀገር ውስጥ የተጻጻፏቸው ደብዳቤዎች ፤ አዲስ አበባ፣ 2003 ዓ.ም.
A collection of the correspondence of Emperor Menelik presented by Paulos Gnogno, a famous journalist and writer. The posthumous work, published in 2011, presents 2242 letters, addressed to issues with Ethiopia or written within Ethiopia (622 pages).
– ጳውሎስ ኞኞ፣ አጤ ምኒልክ፣ በውጭ ሀገራት የተጻጻፏቸው ደብዳቤዎች፣ አዲስ አበባ፣ 2003 ዓ.ም.
This is a collection of the correspondence of Emperor Menelik presented by Paulos Gnogno, a famous journalist and writer. The posthumous work, published in 2011, presents 1043 letters showing his communication with foreign countries, mainly Europe (336 pages).
– አባ ሓጐስ፣ ሽፋረ፣ ውደሴ ዘዕለተ ብርሃን ውእቱ ቃለ ስባሔ ወውዳሴ አምላክ፤ 2007 ዓ.ም.
This book, published by Abba Hagos Shǝfara in 2014, presents a collection of Ge’ez hymns sung on Sundays according to the Ethiopian Liturgy. It begins with an explanation of sacred objects kept for the liturgy, prayers said before the Eucharistic celebration, the Praises of Mary (ውዳሴ ማርያም) and Mystagogy, the prayers of Kidan (prayer of the covenant), the Hymns of Sundays, Responsorial psalms (ምስባክ), intercessory prayers, solemn vespers of major feasts and biblical texts fitting to the liturgical seasons.
– መሪጌታ ሐዋብርሃን ወልደ ሚካኤል፣ አክሲማሮስ፣ ሕንጻ መነኮሳት፣ ግሩም ቅዳሴ በግእዝና በአማርኛ፣ የጸሎተ ሃይማኖት አንድመታ ትርጓሜ፣ 2006 ዓ.ም.
This book, published in 2014 by Merigeta Hawaza Berehan, has various texts: A Ge’ez-Amharic version of the Hexameron (a theological treatise describing God’s work on the six days of creation), a text on the edification of monks, a Eucharistic prayer (Ge’ez-Amharic) and an Amharic commentary of the creed.
– ያሬድ ሽፈራው (ሊቀ ሊቃውንት) መጽሐፈ ግስ ወሰዋስው መርኆ መጻሕፍት፣ በሕር ዳር፣ 2002 ዓ.ም.
This is a grammar by Yared Shiferaw, an Ethiopian traditional scholar, teacher of Ge’ez Qenie and commentaries of the New Testament. The book focuses on the conjugation of Ge’ez verbs accompanied by examples that show their usage. The verbs are classified according to the Ethiopian alphabetical order. However, one should remember that, unlike in dictionaries, it is the last syllable of each word that is taken as a basis for the alphabetical order. The book has been reprinted for the third time, the first edition being in 2005.
– ሮደስ ታደሰ፣ መጽሐፈ ሰዓታት፣ ንባብና ትርጓሜው (በአንድምታ)፣ 2006 ዓ.ም.
The liturgy of the hours composed by Giorgis of Gaseccha, is published by Rodas Tadesse, in 2014, with its Amharic commentary. The prayers reflect deep theological (Trinitarian, Christological, ecclesiological and Mariological) themes.
– ፊዮደር ደስቶየቭስኪ፣ ወንጀልና ቅጣት፣ ተርጓሚዎች፡- ካሳ ገ/ህይወት ፈንቱ ሳህሌ፣ ሻማ ቡክስ፤ 1997፤ ዓ.ም.
This is a translation into Amharic of Dostoevsky’s Crime and Punishment, by Kassa Gebre Hiwot and Fantu Sahle, published in 2005. The translators, in their notice and acknowledgement at the beginning of the book, affirm that the work is fruit of their desire of allowing Ethiopians to have access to famous pieces of Russian literature. The translators had lived and worked in the former Soviet Union.
– መልአከ ፀሐይ መልክአ ክርስቶስ ነቢዩ (ተርጓሚ)፣ ዜና አይሁድ፣ አዲስ አበባ፣ ኢትዮ ጥቁር አባይ፣ 2006.
This is a new edition of Josippon in Ge’ez with an Amharic translation by Mel’ake Tsehay Melke’a Kerestos. Printed in 2014, it has 433 pages. The work is a Ge’ez translation, from the Arabic, of the chronicle of Jewish history from Adam to Titus attributed to Josippon of Joseph Ben Gorion, in Ethiopia known by the Yoseph Wolda Korion. There has already been an edition of the Ethiopic version of Sefer Yosipon by the Egyptian Coptic Scholar Murad Kamil in 1938, based on 8 Ethiopian Manuscripts. This new edition has an introduction in Amharic in which mention is made of previous editions of this work. As for the format, each page has two columns. In the first one finds the Ge’ez text and a literal Amharic translation of the former in the second column, yet without annotations.
– ኅሩይ ባየ (መ/ር) ቅዱሳት መካናት፣ አዲስ አበባ፣ ያሬድ ማሳተምያ፤ 2006.
This book is on Holy places and Sanctuaries of the Ethiopian Orthodox Tewahido Church. Published in 2014, it has 300 pages. It offers a description of 36 Holy places, including hagiographical and historical information. Sometimes the author includes details of his own field research on a given Sanctuary. Poems are also included here and there composed in relation to the religious setting. Information is also given by the author as to the current situation of the sites as well as some recommendations.
– ጠና ደዎ፣ ሰው፣ ግብረገብና ሥነ–ምግባር የዘመናችን ቁልፍ ጉዳዮች፤አዲስ አበባ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ 2008 ዓ.ም.
This is a book written in 2016 by Tena Dewo on moral philosophy. It has 503 pages. After a preliminary chapter on the meaning of philosophy, the following topics are dealt with: (Part I) Ethics and Morality, Concepts and theories of Ethics and morality, Rights and duties of Morality, Ways of developing Good behavior, Modern Moral Problems; (Part II) The Ethiopian People and its Moral life, Moral in Ethiopian Politics, Ethiopian Intellectuals and Morality, the International Context, the Youth and Morality, Recommendations.
– ወንድወሰን ተሾመ መኩርያ፣ የልጆች ባህርያትና የአስተዳደግ ጥበብ፤ አዲስ አበባ፣ ናሌህ፣ 2008 ዓ.ም.
This book is on Child behavior and the art of education. It has 398 pages and 13 chapters. The author Wondewossen Teshome, affirms that he has written the book for parents, tutors, teachers and trainers. The book combines both Ethiopian wisdom and the finds of modern Child psychology and Pedagogy.
– ኃይለ ገብረኤል ዳኜ፣ ባህልና ትምህርት በኢትዮጵያ፣ አዲስ አበባ፣ አዲስ አበባ ዮኒቨርሲቲ፣ 2007 ዓ.ም.
This is a collection of Hailegabriel Dagne’s articles previously printed in Amharic (Part I) and in English (Part II) on Education in Ethiopia and published in a new format with 359 pages, in 2015. The purpose of the collection is to make it easier for students to consult the works of the above mentioned author. The articles focus on Ethiopian traditional Christian and Muslim education with detailed descriptions. Besides attention is also given to the “old age incidental education” and “modern Western education”.
-ድርሳነ ቄርሎስ ወጰላድዮስ ምስለ ተረፈ ቄርሎስ፣ ከቀድሞ አባቶች ጀምሮ ሲነበብና ሲተረጐም የመጣው ንባቡና ትርጓሜው በአንድምታ፣ 2008 ዓ.ም. አዘጋጅና አሳታሚ ሊቀ ሊቃውንት ዕዝራ ሐዲስ).
This is an Amharic Commentary of the Ge’ez text, called Cyril (in reference to Saint Cyril of Alexandria), consisting of a patristic collection, and being one of the most important work for the Theology of the Ethiopian Orthodox Tewahido Church. The translation of the Ge’ez text has been made from a Greek Vorlage although some sections are allegedly translated from Arabic. The Amharic commentary is published in 2015 and has 833 pages. It has prepared and published by Ezra Hadis, a traditional Ethiopian Scholar, teacher and administrator of the Holy Saviour Church in Gondar.
– ሃይማኖርተ አበው፣ ከቀድሞ አባቶች ሲወርድ የመጣው ንባቡና ትርጓሜው በአንድምታ፣ ጎንደር፣ 2007 ዓ.ም. (አዘጋጅ፣ ክቡር ሊቀ ሊቃውንት መንክር መኰንን፤ አሳታሚ፣ ሊቀ ሊቃውንት ዕዝራ)
Haymanota Abaw, literally “The faith of the fathers”, is a collection of writings of Church Fathers as well as Patirarchs of Alexandria and Antioch, translated from the Arabic into Ge’ez probably in the 16th century. This book, published in 2015, is a Ge’ez-Amharic commentary (Andemta) of the above mentioned text. It has been prepared by Menker Mekonen edited by Ezra, both traditional scholars, teachers and administrators at the Holy Saviour Church in Gondar. The work has 1044 pages. Before this commentary, one may remember the edition of the text in Ge’ez and Amharic in 1967.
Apr 17 2015
Pour des Frontières ouvertes entre le Temps et l’Eternité
Rafiq Khoury, Pour des frontières ouvertes entre le Temps et l’Eternité, Tome 1 Bethléem 2012, 547 p. / Tome 2 Bethléem 2014, 571 p.
( رفيق خوري، من ﺃجل حدود مفتوحة بين الزمن والأبدية )
Depuis 2012, le P. Rafiq Khoury travaille à l’édition des articles ou conférences, qu’il a publié depuis plus de 25 ans et qui sont dispersées ici ou là dans les diverses publications. En fait, il ne s’agit pas d’une simple réédition, mais d’une révision générale de tout ce matériel à la lumière des événements qui se sont succédés, tant en Palestine que dans le monde arabe et dans le monde en général, depuis la publication de ses articles ou conférences. En plus, ce matériel n’a pas été rassemblé à tout hasard, mais d’après les sujets qu’ils traitent, ce qui fait que chaque volume traite – autant que c’est possible – d’un sujet homogène.
Cinq volumes, au moins, sont prévus et portent le titre général de Pour des Frontières ouvertes entre le Temps et l’Eternité. Ce titre est inspiré de la sixième Lettre pastorale des Patriarches catholiques d’Orient, où nous lisons: «Dans ce mystère [le mystère de l’Incarnation], Dieu et l’homme se rencontrent. C’est la rencontre de l’éternité de Dieu avec le temps de l’homme. Par ce mystère, Dieu a sanctifié le temps et en a fait, avec toutes ses circonstances et ses particularités, un espace pour notre vocation et notre témoignage. Dieu est entré par le Christ dans notre histoire humaine afin d’en faire une histoire du salut dont nous sommes les témoins. Car nous vivons dans l’histoire sans oublier l’éternité, et nous vivons dans l’éternité sans oublier l’histoire humaine. Par l’Incarnation, le temps et l’éternité deviennent deux faces d’un unique projet de salut dont le but est de redonner à l’homme la beauté de l’image de Dieu» (n. 5).
Deux volumes ont été déjà publiés par le centre Al-Liqa, le premier en 2012 et le second en 2014, tandis que le troisième est en cours de préparation et qui a pour sujet la relation avec l’autre (A partir d’un regard général sur l’autre, ce nouveau volume traitera de l’Œcuménisme, du dialogue interreligieux, des diverses relations dans la société…).
Le premier volume
Pour des Frontières ouvertes entre le Temps et l’Eternité (1), Vers une Théologie incarnée dans le Sol de nos Pays, avec introduction du Patriarche émérite Michel Sabbah, Publications du centre Al-Liqa, Bethléem, 2012, 547 pages (en arabe).
Comme l’indique son titre, ce premier volume réunit les articles qui ont un rapport avec la théologie contextuelle, qui ne cesse de se développer en Palestine depuis plus de trente ans. Il suffit de parcourir les titres pour s’en rendre compte: La Théologie en Palestine, sens et contenu (pp. 255-283), De la situation théologique à la réflexion théologique (pp. 175-195), Inculturation et foi chrétienne dans les Eglises du monde arabe (pp. 197-222), Une pensée nouvelle pour des temps nouveaux: les Lettres des Patriarches catholique d’Orient (pp. 223-253), Le Mystère de la Sainte Trinité, projet divin pour le monde de l’homme: une méditation sur l’icône de la Sainte Trinité de André Roublev dans le contexte du monde arabe et de ses Eglises (pp. 287-326), Jalons pour une Christologie orientale dans les lettres des Patriarches catholiques d’Orient (pp. 327-359), Les implications théologiques du conflit actuel en Palestine (pp. 421-452), Pour une synthèse théologique moderne dans le monde arabe (pp. 503-527)… Il en va de même pour les autres articles. Comme annexe à ce volume figure le document publié par le centre Al-Liqa Théologie et Eglise locale en Terre Sainte (pp. 529-545). Dans l’introduction, l’auteur dit: «J’ai essayé de vivre dans une attitude d’écoute à tout ce qui se passe dans la conscience des Eglises de notre région et leurs peuples. Cette écoute est l’écoute d’un croyant, qui essaie de réfléchir à tout cela à partir de sa foi».
Le second volume
Pour des Frontières ouvertes entre le Temps et l’Eternité (2), La présence chrétienne dans le l’Orient arabe entre passé, présent et avenir, avec une méditation préliminaire du Patriarche émérite Michel Sabbah et une introduction de Bernard et Mary Sabella, Publications du centre Al-Liqa, Bethléem, 2014, 571 pages (en arabe).
Le second volume réunit les articles qui traitent de la présence chrétienne en Palestine et dans le monde arabe. Il est à rappeler que ces articles ont été revus à la lumière de tous les événements de ces dernières années.
Comme l’indique le titre, le volume traite de la présence chrétienne dans l’Orient arabe dans ses diverses dimensions historiques, le passé, le présent et l’avenir. Pour ce qui est du passé, le volume commence par un long article sous le titre La présence chrétienne dans l’Orient arabe: un parcours historique global, qui retrace la présence chrétienne à travers les diverses périodes historiques (les six premiers siècles, la période musulmane à partir du VIIème S., la période ottomane à partir du XVIème S., la période moderne avec la renaissance arabe au XIXème S.). A cet article de caractère historique suit un autre, aussi long, de caractère critique sous le titre La présence chrétienne dans l’Orient arabe, approche critique pour une présence renouvelée, qui vise à relever les points négatifs de cette présence en vue d’un renouveau. De ces points négatifs nous sommes appelés à nous en libérer («La liberté vous rendra libres»: la libération de l’homme chrétien dans l’Orient arabe de ses chaînes intérieures, pp. 323-372). Quant au présent, un article essaie d’énumérer les divers défis que les communautés chrétiennes affrontent dans le monde arabe (défis concernant la foi, défis ecclésiaux, défis de la société) (pp. 183-209), sans oublier les défis représentées par ce qu’on appelle «le printemps arabe» (et qui ne l’est pas), pour présenter quelques réflexions sur la présence chrétienne dans ce cadre (la présence chrétienne dans l’Orient arabe dans le contexte des «révolutions» arabes, pp. 211-239).
Pour ce qui est de l’avenir, l’auteur entrevoit cet avenir sous le signe du renouveau de la foi, dans ce sens qu’une foi superficielle aboutit à une présence superficielle. Dans cette perspective, un article expose la signification de la nouvelle évangélisation dans les Eglises du Monde arabe (Pour une nouvelle évangélisation dans nos Eglises de l’Orient arabe, pp. 241-322), suivi d’un autre au sujet de la parole du Christ «Que dites-vous que je suis» (Une question qui ne cesse de nous défier et une réponse qui ne cesse de nous attendre, pp. 373-403). Dans cette perspective, un regard sur la tradition et les traditions dans nos Eglises d’Orient, dans lequel une approche critique est développée (Tradition et traditions dans les Eglises d’Orient: approche critique, pp. 407-430).
Le volume se termine par deux lectures, celle du synode des Eglises catholiques de la Terre Sainte (pp. 533-546) et une autre du synode des évêques sur le Moyen Orient en 2010 (pp. 513-532). Le volume est traversé par une grande espérance, entre un «déjà» et un «pas encore». Il se termine par ces paroles: dans cette espérance «nous attendons et nous agissons».
Mar 28 2015
(Deutsch) Das Christentum in Nubien. Geschichte und Gestalt einer afrikanischen Kirche
Roland Werner, Das Christentum in Nubien. Geschichte und Gestalt einer afrikanischen Kirche, Berlin: LIT 2013, 520 S. = Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte 48), ISBN978-3-643-12196-7
Dec 26 2014
(Deutsch) (English) Some Remarks on the Evolution of Islamism in the Middle East
Introduction
According to Ashgar Ali Engineer in his text on Religion and Communalism (http://www.asianoutlook.com/articles/june/29.htm), human beings cannot live without religion or some kind of ideology which gives human life a meaning and direction and whatever the nature of ideology or thought or value system it creates its own ‘other’. It follows that some form of struggle starts between followers of one or the other ideology. Religion can be defined as a system of beliefs and values with associated rituals to give these beliefs and values a concrete form. When these beliefs and values are held in common and rituals are performed it gives rise to a sense of commonality and a religious community comes into existence. This community is also product of a pre-existing social structure and this social structure deeply influences the religious community and its practices. No religious community can totally transcend this pre-existing social structure. One thing at least seems certain: a religious community induces a sense of identity. This identity, for its members, in course of time, becomes more important than the beliefs and values. And it is this sense of identity, which creates problems rather than religion would do, since over assertion of differences often lead to religious tension and social unrest. It is important to keep this in mind. It is equally important to note that a community exists in this world and hence represents worldly interests of its members. These worldly interests become as important, if not more, as religious beliefs, rituals and values. In any event, religion permeates the life of people in the Middle East. It is an ongoing concept with increased influence and continues to claim a prominent role in attempts to understand the past, to grapple with the present, and sometimes to prophesy the future1. Recently, the question of the role of religion in the modern world has taken on a new and urgent intensity.
Islamic discourse in confusion
It is obvious that since the advent of modern times Islam has faced the fundamental challenge of modernity. Over the past few decades, many Muslims began to feel that it was time to stop importing foreign ideologies, ideas, and concepts, and instead sought to attain a more indigenous form of collective identity and expression: Islam. Hence, Islam has emerged with a political profile on the international arena. In the second half of the 1970s political Islam or Islamism began to influence interstate regional politics and international relations. This development has been accompanied by a desire among Muslims for a greater ‘authenticity’ in the understanding and implementation of the social, moral, political and economic imperatives to be discovered in the Qur’an and the Hadiths. The search for authenticity, purity, and uniqueness has led to the articulation of political policies with Islamic edge at a national, regional and international level. It is, of course, clear that Islam came to play an important and powerful role at multiple levels as millions of people sought to make it a more central part of their lives2. Today, the Islamic discourse is influenced by the political, intellectual and cultural circumstances prevailing in the Muslim countries and the economic, social conditions, and mental formations affecting their societies. It seems rather more to the point to consider the internal and historical variations of the Islamic cultural traditions as structured historical units, subject to evolutionary and revolutionary change. Being an expression of the prevailing conditions, the Islamic discourse swings between strength and weakness, moderation and extremism, ability and feebleness, adequacy and inadequacy, depending on the environment, the society, and the internal to the external circumstances in which it evolves.
There is reason to believe that the reversion to Islamic teachings and ethical ideal is the result of uneven economic development in the post-colonial era. Conditions of inequality, economic oppression, and historical injustice have given rise to passive emotions in many Muslim countries. Precisely because Muslims were weak militarily and politically they responded to the challenge by seeking refuge in their faith, whereby the discourse of umma (community of believers) revivalism provided an identity, a purpose, and a wide range of methods for social struggle particularly in the Middle East. Their anger was expressed in religious language. Hence, the rise and spread of Islamic conservative discourse and Islamic fundamentalism can be traced back to three interacting factors. The first is the cultural contradiction produced by the rapid access to modernity in most Muslim countries. The second is the crisis of efficiency and legitimacy of the political systems established after independence. The third is the intense demographic growth without adequate economic development3. The relative material deprivation has led to feelings of alienation, frustration, and hence, a growing sense of powerlessness. Against the background of disappointment, bitterness and gloom in this life, fundamentalism became a ray of light, provided emotional fulfilment, and inspired the faithful Muslim with hope in this life and eternal grace in the life to come.
When the question is posed, why, after a variety of experiments in social change over nearly a century, do Muslim societies remain economically underdeveloped, poor, and politically repressive? Muslims, traditionalists and fundamentalists alike, would claim that a return to Islamic heritage would resolve these problems4. That is to say that a strict adherence to Islam and its norms is the only answer, for Islam is believed to be the vehicle by which one can realize God’s ultimate unity (tawhid). Its message is pervasive in the sense that covers all aspects of life and society. In fact, the Muslim Brotherhood movement viewed Islam as a total system that transcended national boundaries, believed in the unity of religion and politics, and considered Western culture decadent. It follows that all the precursors of Islamic fundamentalism insisted on unconditional fealty to Islam and questioned the validity of any sources of learning that were outside the Islamic cosmological doctrine5. Their struggle at Islamizing society ranged from the development of a defined ethical self and the establishment of community organizations and social welfare institutions (Muslim Brothers and Salafi movements), to the mobilization of violent insurrection groups and guerrilla warfare (al-Jihad, al-Jama’a al-Islamiyya and al-Qaeda networks). It is obvious that such variation is not about purpose but rather in the methods they used. While the radical Jihadis with their extremism, revolutionary path, and hateful discourse are willing to do anything to establish an Islamic political order even in non-Muslim societies, the non-violent trend in the Islamic movement is pragmatic, engaged in advocating social transformation and has developed a moderate discourse which illustrates an ambiguous respect of some civil liberties, human rights, and the acceptance of certain democratic elements. In fact several Islamist movements in a number of Islamic countries have sought to advance their political agendas through contesting elections. Recently, they even have experienced success at the polls, as evidenced by elections in Egypt, Bahrain and Palestine. With Islam as its reference this discourse claims that it is not inherently anti-Western and some of its representatives are keen to build bridges of understanding and communication with people and institutions in the West. Yet, many observers still question their real commitment to democracy.
Initially, it is important to note that the resurgence of political Islam is a counter-process to unhappy encounter with the West and its modernity. Many Muslims were unable to see, what went wrong? What caused the decay of their past heritage? And what contributed to their marginalization and impotence? Furthermore, they were unable to reconcile their modern reality (pervasive humiliation from comparison between present misery and past achievements) with God’s proclamation: “You are the best umma created (by God) on earth”6. The Arabs in particular were unable to concede the disastrous and humiliating defeat in the 1967 six-day Arab-Israeli war. Secular Arab nationalism had been proved a failure and was dead. It was in this time of great danger, difficulty and anxiety that the fundamental voice claimed that negligence in applying Shari’a (Islamic law) provoked the anger of Almighty God. That is to say that the crisis is a form of God’s punishment resulting from laxity in applying God’s rules. This voice called for tawba (the notion of repentance) and a return to religion. With the passage of time, a broad acceptance of the fundamentalist message developed throughout the Muslim countries that the reason for the plight of Muslims is that they and their governments had fallen away from the original principles of Islam. Thus, people were able to realize what they had left behind and remembered what they had forgotten. A return to the straight path of Islam will restore the identity, power, and wealth of the Muslim umma. In this context, fundamentalist theorists such as Hasan al-Banna and Sayyid Qutb in Egypt, Abul A’la Mawdudi in Pakistan, Mustafa al-Siba’i in Syria, Abbasi Madani, Mahfouz Nahnah, and Ali Belhaj in Algeria, Hasan al-Turabi in Sudan, Rashid al-Ghannushi in Tunisia, and Abu Bakr Bas’asyir in Indonesia, adopted an identifiable approach to a common obligation to implement the fundamentals of the truth in the Qur’an and Sunna in their lives and societies. They believed that Islam as a body of faith has something important to say about how politics and society should be ordered in the contemporary Muslim world. Therefore, Islam forms the ideological and often the cultural and social context for their sophisticated movements of reaction against modernity and its threatening features of contemporary world7. Given the diversity of their backgrounds, cultures, and differences in time and space, there are considerable variations in their discourse and orientations. At the same time, understanding the dynamics of the sometimes contradictory discourses on any given issue requires an appreciation of the diversity of the contemporary Islamic experience.
So it can easily be seen how the Islamic fundamentalist movements do not constitute a monolithic phenomenon. Each movement is shown to have been a belated reaction to internal and external forces. Though they share the common purpose of establishing a new social and political order based on Islam (Islamizing society) and have similarities in the vocabulary of their discourse, there is an infinite variety of ideological differences. They differ also on how this goal should be realized. As there are various insights into the Islamic ethical ideal contained in the sacred text, many fundamentalist movements divided along ideological and sometimes sectarian lines. For instance, while the vast majority have insisted on the application of Shari’a with a more ambitious agenda for its implementation, the promotion of the Islamic law has not been the priority of other fundamentalist groups in Indonesia, such as the Laskar Jihad and Jema’ah al-Turath al-Islami and Islamic Youth Defence Surakarta. These groups should be considered among the Salafis. Some of them do subscribe to violence and are called Salafi Jihadis8. Furthermore, while most of the Salafi movements prefer to stick to their traditional activities, like personal salvation through faith (iman), preaching (da’wa), and the promotion of Islamic law, some Salafis are not political activists and their groups restrain themselves from adopting a political agenda like the majority of Indonesian Salafis and the Tablighi Jama’at group in Indo-Pakistan. Again, while some fundamentalist groups are pluralistic in terms of inter-Muslim relations and relations between Muslims and minorities, others are not9. The fact is that some fundamentalist groups, while ideologically radical, might nevertheless be nonviolent in their methods.
On the other hand, there are movements that make no distinction between politics and religion, regard Islam as a complete, unchangeable and finished system and are usually associated with authoritarianism10. Their ideology is based on an assumption that Islam has a predominant political mission. Hence, the ability to practise Islam fully as a religion is dependent upon the ability to create an Islamic political system. What is particularly noteworthy is that political Islam comes in many strains and certainly not all are marked by an attachment to violence. Some Islamic movements cannot be easily labelled as radical or moderate, because radical and moderate wings can coexist within the same movement. Furthermore, extremist groups can evolve into moderate ones, and moderate groups can become radicalised11. However, while it may be appropriate to speak of the Muslim Brotherhood’s movement within Egypt as non-violent (it has given up on the use of force since the late 1960s), some of its branches and sister- movements outside Egypt do subscribe to violence as a method of achieving their ends. The Islamic resistant movement (in the Gaza Strip) Hamas is a case in point. It is one of the wings of Muslim Brotherhood in Palestine. It is further of interest to note that, Sheikh Yusef al-Qaradawi, the most authoritative Muslim theologian who is associated with the Muslim Brotherhood, while condemning terrorism in Britain; he supports suicide bombings against Israel referring to it as form of Jihad12. It has often been noticed that, though the growth of several radical Islamic groups occurred outside the context of the Muslim Brothers, the organization of the Muslim Brotherhood remained the mother organization from which the various splinter militant groups sprang13. Having spent years in jail and endured its brutality, many young Brothers turned radicals.
Among the Muslim Brotherhood members in Egypt, was the prominent thinker and ideologue Sayyid Qutb who was executed in Cairo in 1966. He is the author of a number of controversial writings, which had a significant impact on Muslim fundamentalists up to the present day. Qutb’s writings such as In the Shadow of the Qur’an, and Milestones, first started to circulate widely among the Muslim Brothers, exercising a powerful influence on the regeneration and redirection of Islamist ideology14. Qutb’s basic ideas about Jihad are found in chapter four in his controversial work Milestones, published in 1964. In this chapter, Qutb explained his thesis of how to turn Islam into a political movement in order to create a new society based on Qur’an principles. In this new society, domination (hakimiyya) should be reverted to God alone. Hence, the ultimate objective is to re-establish the Kingdom of God on earth with Shari’a as the law of the land. He considered that modern society is a sinful one because it existed in a state of jahiliyya (i.e. pre-Islamic barbarity) with moral ignorance. In another book, Qutb described modernity as responsible for stripping humanity of its spirituality and its values and reducing human beings to the level of animals. In order to bring society out of the yoke of this modern jahiliyya and revert to the sole domination of God (hakimiyya), it would be necessary to form a vanguard of faithful and dedicated Muslims prepared to undertake Jihad through armed struggle against the existing sinful modern society15. If the term jahiliyya should refer to the period of ignorance in pre-Islamic Arabia, Qutb has adapted it to the contemporary period to mean a similar state inherent in modernity. Qutb wrote:
“We are also surrounded by Jahiliyya today, which is of the same nature as it was during the first period of Islam, perhaps a little deeper. Our whole environment, people’s beliefs and ideas, habits and art, rules and laws – is jahiliyya, even to the extent that what we consider to be Islamic culture, Islamic sources, Islamic philosophy and Islamic thought are also constructs of Jahiliyya. It is, therefore, necessary….that we should remove ourselves from all the influences of the jahiliyya in which we live and from which we derive benefits. We must return to that pure source from which those people derived their guidance, the source which is free from any mixing or pollution”16.
According to Qutb the condition of jahiliyya prevailed in Egypt, where the people were no longer worshipping God but revering Nassir and his regime.
It was, indeed, Qutb who boldly expressed the view that God alone possesses truth and human beings must simply have faith in that fact. Furthermore, he made an assault on the historical evolution of the Islamic experience. In his view, the lessons to be learned from the early Muslims are not to be found in the rules they articulated but in their response to the challenges they encountered. Having lived in the first period of jahiliyya, they responded with revolution. Hence, contemporary Muslims must respond similarly to the challenge of modernity (modern jahiliyya) in this age of secularism. He defined the road as follows:
“Our aim is working to change the jahili system at its very roots…. Our first step will be to raise ourselves above the jahili society and all its values and concepts. We will not change our own values to make a bargain with this jahili society. Never!” “Islam is God’s religion for the whole world. It has the right to take the initiative. It has the right to destroy all obstacles in the form of institutions and traditions…..in order to release mankind from servitude to human beings so that they may serve God alone”. “To proclaim the authority and sovereignty of God means to eliminate the dominion of Man and to establish the rule of the kingdom of God over the entire earth.” “We know that in this we will have difficulties and trials, and we will have to make great sacrifices”17.
There is little doubt that Qutb’s ideas on jahiliyya, the sovereignty of God, and jihad owed much of their original inspiration to the writings of Hanbali jurists such as Ibn Taymiyya (d.1328), his disciple Ibn Qayyim al-Jawziyya (d.1350) in addition to Abu al-A’la Mawdudi (1903-1979). In fact, Qutb quotes extensively in his Milestones, from the book Zad al-Ma’ad of Ibn Qayyim al-Jawziyya. As far as Abu al-A’la Mawdudi is concerned, he has discussed the concept of jahiliyya and was the first to condemn modernity and to emphasise its incompatibility with Islam18. Qutb borrowed heavily from Mawdudi’s vision of an Islamic state, but he broke new ground in his analysis of how to realize it. In fact, it was Qutb who radicalized these ideas and produced a programme for political Islam, the purpose of which is the creation of a universal political system in which national and ethnic differences are to be disregarded. Current political systems in the Muslim world, as well as the political systems in the West, were seen as obstacles to this scheme. Since belief alone cannot be complete unless it is coupled with action, it is conceivable that violence is an indispensible means to the achievement of such a system. In a word, Qutb’s Milestone provided the religious justification for all Muslim radical groups and showed them the way forward19.
It may not be irrelevant to note that the defeat of three Arab countries by Israel in June 1967 and its after-effects, the failures of the Arab regimes to build socio-economic justice in their societies, and their failure to reach a satisfactory and just solution to the Palestinian problem, have only served as a fertile ground for the growth and spread of Qutb’s programme of Islamism in the Muslim world. It is quite clear that his radical vision was a product of the crises of contemporary social and political conditions in the Middle East. Precisely because of the widespread poverty and the staggering figures of illiteracy in many Muslim countries, his discourse became the basis of many new militant political discourses. His writings constituted the guide for the ideas and practices of the radical Islamic groups in the Middle East. In the course of time, Qutb’s books have been translated into most languages that Muslims read and have exercised a formative influence on “global jihadism”: the Taliban and al-Qaeda international networks, which harbour a hatred for, and advocate violence against, all versions of a consensual world order20.
While understanding how Qutb’s ideas have influenced and continued to inspire many younger Brothers, the old guard brotherhood leaders, nonetheless, felt that Qutb had gone too far. They opposed the radical tendencies articulated in his manifesto (Milestones), particularly the practice of identifying someone as unbeliever (kafir), and the call for active revolution in order to revert domination (hakimiyya) to God alone21. Hence, the Brotherhood leadership repudiated the more radical and militant ideas of Qutb informally in 1969 and formally in the early 1980s. This in turn would seem to have created disputes within the Muslim Brotherhood in Egypt, with radical members at times breaking away to form secret revolutionary groups committed to the use of violence in the 1970s; among them, al-Jihad, al-Jama’a al-Islamiyya and al-Takfir wa-l Hijra (Apostatization and Migration) with divergent and conflicting interpretations of Qutb’s teachings. But they agreed on declaring Jihad against the jahili regime in Egypt22. Thus, Islamic militant groups have become a phenomenon in many parts of the Muslim world since the mid seventies and were strengthened by the 1979 revolution in Shi’ite Iran. All of them shared the background of negative social and economic conditions, colonial experience, and a rigid religious tradition. It was only under conditions of crises, when the government was weak or excessively oppressive and corrupt, that rigid religious traditions tended to assert themselves and gained ascendancy. In order to communicate anger and disappointment at the government, the mosque became an appropriate place where political opposition was articulated. In this way the militant movement has been particularly powerful as the principal opposition force in several Muslim countries like Egypt and Algeria23.
The decentralization of religious authority in Sunni Islam
Unlike the situation in Western Christendom, where religious authority was concentrated in the Roman Church until the Reformation, there was no single source of religious authority for the domains under the control of the Muslim caliphate. Precisely because there was no single locus of religious authority within Islam, religious doctrine was highly fluid and hotly debated. In Shi’ite theology, however, God does not guide solely through authoritative texts, but through specially equipped humans, the imams of the community. Since those imams were the spiritual successors to the Prophet Muhammad and proper heirs to his authority, they were and still are unable to err in pronouncing dogma as doctrinally defined. This concept is called wilayat ul-faqih. While the Shi’ites developed this rather elaborate clerical hierarchy in the sixteenth century, Sunni Islam religious authority continued to be decentralized24. One would not, in fact, be wrong in saying that the absence of a hierarchically organized clergy capable of acting as the central religious authority and scriptural interpretation and the consequent nonexistence of institutional mechanisms within the religious infrastructure to control extremists, made Sunni Islam vulnerable to manipulation. This in itself “provided a great deal of scope for religious entrepreneurs to advance their political and personal goals in the name of Islam”25.
Traditionally, the ‘ulama and fuqaha (Islamic religious scholars) were guardians of the Islamic faith and the leading authorities in religious matters. In the past they were divided by the schools of Islamic law to which they belong. Their legitimacy rested on their possession of religious knowledge, partial independence from the state and their dual function of representing the interests of the state to the laity and the interests of the laity to the state26. As long as the rulers protected the domains of Islam (dar al-Islam), promoted Islamic law, and didn’t interfere with their Muslim subjects’ practice of the faith, the ‘ulama gave a title of legitimacy to the political institution and accepted their rulers’ right to rule. The point of all this is that in the classical age of Islam religious and temporal spheres had for all practical purposes come to be considered quite separate. Furthermore, from the very beginning tolerance of both diversity of views within schools of Islamic thought and of other faiths was the rule rather than the exception.
Yet, with the advent of Modern times and decline of Islamic civilization, “the traditional institutions that once sustained and propagated Islamic orthodoxy – and marginalized extremism – have been dismantled”27. It was from the 17th century onward in the Ottoman Empire, that the state’s domination of the religious sphere was institutionalized when the senior religious functionaries were incorporated into the imperial bureaucracy and Sheikh ul-Islam (a prestigious position that governed religious affairs) served at the pleasure of the Ottoman Sultan. However, it is fair to say that, when most Muslim nation states gained independence from the political hegemony of the West around the middle of last century (between 1947 and 1963), the state has grown extremely powerful and centralized at the expense of the authority and autonomy of the ‘ulama. The most vivid scene in various Muslim countries is a type of Islamic autocracy, in which leaders use Islam to justify and concentrate their own powers. To do that, the state had to control religious institutions such as mosques, schools of religious learning, state offices producing textbooks and statements related to Islam. In most Muslim countries, the state now tightly controls the private religious endowments (awqaf) that once provided for the scholars of religion. This development took place in Egypt in 1961, when Nassir nationalized al-Azhar and placed the mosque-university under the supervision of the Ministry of Endowments. All its finances were to be directed through the appropriate state channels. Moreover, a law was enacted to institute as part of al-Azhar University a school of medicine, a school of engineering, a school of agriculture, and a college for women. This reform also involved major administrative changes within al-Azhar. Whereas, the Egyptian regime sought control of al-Azhar to secure fatwas (religious legal opinion) that safeguard its domestic security and legitimize foreign policy, it soon became obvious, from a religious point of view, that the wholesale reform have far-reaching effects on the texture of society. A worthwhile class of physicians, engineers and agriculturists was created with some knowledge of and an interest in Islam28.
On the other hand, it followed from this reform that Al-Azhar, as Sunni Islam’s most esteemed institution of religious learning became an arm of the Egyptian government and the state has co-opted the ‘ulama, i.e. the establishment ‘ulama and transformed them into its salaried employees. Of course, the state assumed the authority to appoint al-Azhar’s Grand Imam (Grand Sheikh) and the State mufti. It should be noted that Dar al-Ifta’ (department of fatwa) was instituted in 1895 to provide official guidance for the Egyptian State and public on how to live in accordance with the requirements of Islam. It is not under the jurisdiction of al-Azhar, but under the supervision of the Ministry of Justice and it directs its fatwas to the Muslim umma as a whole. Hence, this transformation has reduced legitimacy of the state- appointed ‘ulama, diminished the popular authority they once enjoyed, and created a profound vacuum in religious authority. It was a mere coincidence that this development took place when Islam came to play an important and powerful role at multiple levels as millions of people sought to make it a more central part of their lives in Egypt. For that has proved conductive to the emergence of alternative groups seeking to speak on behalf of Islam29.
It should be noted, however, that the attack on the independence of al-Azhar has provoked opposition among the non-establishment ‘ulama and laid the foundation of a generation of rejectionists within its university30. The ‘ulama’s desire to express more independent views often caused internal dissent with contradictory fatwas in al-Azhar, leading to its further degradation and undermining its ability to speak in one voice and exert religious authority. One can not refrain from remarking that, if al-Azhar is an official institution and subordinate to a secular state, it has, nonetheless, a basic ideological interest in the Islamization of the Egyptian society and the implementation of Shari’a. No wonder that most Azhari ‘ulama are sharing a conservative, literalists approach to Islam and have interaction and mixing with the non-violent Muslim Brotherhood and Salafi groups31. Whereas, the Islamic resurgence of 1980s and 1990s and the subsequent increased interest in religious knowledge and literature allowed the Azhari ‘ulama to interact more effectively with broader segments of society and enhanced their integration in the public political and social discourse, it created, at the same time, the potential for lay fundamentalist organizations and radical groups to speak for Islam. Precisely because, al-Azhar found itself competing with radical groups with an agenda like its own, namely Islamization of society and implementation of Islamic law, it radicalized its own rhetoric accordingly to win the hearts and minds of the people. Thus, al Azhar “became a plural and diversified body that is now itself in competition with other religious entrepreneurs”32.
Again, while the ‘ulama in the Muslim nation states continued to see themselves as the primary interpreters of Islam, they did not hold a monopoly on religious interpretation. The argument here is that the basic principles of Islam have been rendered unalterable and that no religious authority is in a position to subvert or circumvent them. Since there is no official clergy in the doctrine of Sunni Islam, interpretive authority became accessible to sufficiently educated and well informed lay Muslims. That is to say that the power to interpret the sacred text may be granted to any individual who is socially recognized by a given group of people for his piety and knowledge. Though individuals without any official religious status or formal religious education are not authorized to issue fatwas or any form of religious ruling on Shari’a, pluralism is in the tradition of Islamic fiqh that tolerates differences of opinion on matters of interpretation and is said to testify to the flexibility of the Shari’a. According to Sheikh Muhammad ‘Abduh (1849-1905), since the Qur’an must be understood first and foremost through reason, any Muslim who is capable of rational inquiry had a direct responsibility to read, contemplate, and interpret the text for himself. Furthermore, Sheikh Yusef al-Qaradawi also tried to undermine al-Azhar’s monopoly over the field of preaching (da’wa) by claiming that da’wa is not the sole mandate of the sheikhs and the imams of al-Azhar, but is the duty of each and every Muslim according to his abilities33.
It was even before the middle of twentieth century that lay literate Muslims leaped into the arena and claimed the right to interpret Islam. They were not trained in the religious sciences and largely unfamiliar with the accumulated traditions of Islamic theology, jurisprudence, and the tools required to interpret the ethical truth in the Qur’an and Hadith. It is thus, not surprisingly that a process of literal interpretation of the sacred texts without adequate reference to context began to define Sunni fundamentalist Islam. This new group of lay activists, drawn largely from modern professions such as journalism, secular education, engineering, and medicine, along with a few non-establishment ‘ulama began to work out an Islamist ideology which combines religious reform (based on literal reading of the Qur’an) and political mobilization. Three key intellectual-activists, Hasan al-Banna (who founded the Muslim Brotherhood movement in Egypt), Abul A’la Mawdudi (who created Pakistan’s Jama’at-i-Islami), and Sayyid Qutb (godfather and martyr of Islamic radicalism) have been so influential in articulating the vision of Sunni political fundamentalism. With every justification it can be said that, “the leadership of most major Islamic movements, mainstream and extremist, nonviolent and violent alike, has been influenced by their ideas on Islam, Islamic revolution, jihad and modern Western society”34.
The new Jihadist culture
With the emergence of new radical groups in several countries in the Middle East in the 1970s the field of interpretation became dangerous. They took Sayyid Qutb’s interpretation of Jihad, considered themselves the vanguard, and pushed for its realization through armed struggle in the defense of Islam against the existing sinful secular regimes in the Muslim world and Egypt in particular, as well as against the Western governments that have supported them. They sought to overthrow the jahili regimes and create a true Islamic society. Therefore, they were critical of the pragmatic policy of the Muslim Brotherhood and their strategy of gradual change and of working through the established social and political institutions. Yet, it should be noted, that even the radical jihadist movement itself is not monolithic. While subscribing to the same general tenets, there are nonetheless several groupings that differ in terms of cultural background, diversity of objectives, tactical and strategic priorities, and mechanisms of control and organization. However, two distinct strands of jihadism ought to be identified, the first is the doctrinaire jihadists, who have used violence against both their own jahili regimes (the near enemy) and the West and the United States in particular (the far enemy). They include the local secret revolutionary groups in countries like Egypt, Algeria, in addition to al-Qaeda organization. The second is the so-called irredentist jihadists, who struggle to redeem land considered to be part of Dar al-Islam (domain of Islam) from non-Muslim rule or occupation, like the Islamic resistant movements’ al-Jihad, Hamas in the West Bank and the Gaza Strip, Hezbollah (Hizb’allah) in Lebanon, and similar groups in Kashmir, Chechnya and Mindanao in the Philippines35. Since much ink has been spilled and volumes have been written on the jihadist groups and their networks, I will not present a detailed analysis. Yet, critical attention should be turned to the ideological development of radical Islam in the Middle East since the execution of Sayyid Qutb.
It would be true to say that members of the secret revolutionary groups in Egypt (al-Jama’a al-Islamiyya and the Egyptian Islamic Jihad in particular), were frustrated young people from the lower middle class, often university students – especially those who temporarily or permanently resided away from their families. Many of them had rural background. Even young women were extensively involved in activities of the groups. Young militants, men and women, appeared on university campuses to radicalize the student bodies. With the passage of time increasing participation in prayers at mosques, growing beards and wearing the veil among students became fashionable. It should be evident that, recourse to puritanical beliefs is more tempting when people can associate the failure of their governments in meeting the challenges of modernity with a deep economic, social and military crisis. Hence, members of the radical groups integrated the Islamic vocabulary into their political claims. Though they were a minority, the militants engaged the debate about the failings of government and generated many of the radical interpretation about Islam such as the interpretation of Jihad and the injunction of ‘commanding right and forbidding wrong’. They considered it their duty to use force in implementing the principle of ‘forbidding wrong’. Precisely because they were anxious to impose what they understood as God’s will on society and to curb immoral behavior, they adopted a rationale for militancy based on Qutb’s teaching. Their revolt was directed not only against the secular regimes, which they considered as morally sinful, but also against Islamic institutions such as Al-Azhar and the Sufi orders. Such radical ideas eventually filtered into the minds of the illiterate and semi-literate segments of society. Similar development could be observed in other Muslim countries and Algeria in particular, namely a radicalization of thought in the last decades of twentieth century as young Islamists, stimulated by social, economic and political crises, came into conflict with ruling regimes. Thus, the tide influenced modern Muslim perception of the long bygone past and inspired in some young people a mood of violence36.
What needs stressing, however, is that while the rhetoric of the new radical groups accused the establishment ‘ulama of ignoring Jihad, failing to address the moral crisis of society and harmful innovations (bida’); and denounced them for being unable to give more than an official interpretation of Islam that answered the needs of the jahili rulers, some militant groups tended to invite members of the non-establishment ‘ulama to join their organizations and even assume leadership in order to provide necessary spiritual guidance. The blind Azhari scholar Sheikh Omar Abdel-Rahman who is currently serving a life sentence in the USA (for his involvement in the first attack on the World Trade Center in February 1993) is a case in point. He was an associate professor of Islamic religion at Al-Azhar university branch in Asyut (Upper Egypt). In the late 1970s he developed close ties with two of Egypt’s most radical jihadist groups namely, the Egyptian Islamic Jihad and al-Jama’a al-Islamiyya. By the 1980s he became the spiritual leader of al-Jama’a al-Islamiyya, the largest student group in Egypt. As the group was oriented to action rather than to the elaboration of theory, it needed the guidance of the blind Sheikh. He played a key role in defining and articulating the goals, policies and tactics of that group37. The group is responsible for many acts of violence against Egyptian government officials, intellectuals, Coptic Christians, churches, and foreign tourists in Egypt. The fatwas of Omar Abdel-Rahman provided legal and moral dispensation for the group’s acts of violence that are deemed to fulfil Jihad under his extremist interpretation of Shari’a. It is true that he issued fatwas that provided the religious justification for the assassination of President Sadat in 1981, killing and plundering of foreign tourists (preferably Israeli), and for waging a war of urban terrorism against the United States, which included the first attack on the World Trade Center in 199338. These fatwas has been passed on to other groups, the Islamic Jihad which carried out the assassination of Sadat, and al-Qaeda which carried out the massive second attack on the World Trade Center’s twin towers on September 11, 2001.
On the other hand, the group known as the Egyptian Islamic Jihad (Tanzim al-Jihad al-Islami) was first uncovered in 1978. It began as a small underground group in Cairo under the leadership of an electrical engineer in his mid-twenties by the name Muhammad Abdel-Salam Farag. He articulated the ideology of the jihadists in a small manuscript entitled Al-Jihad: al-Farida al-gha’iba (Jihad: The Neglected Duty), which was printed in a clandestine edition after his trial and execution in April 1982. In the opening paragraph, he begins by stating that “Jihad for God’s cause in spite of its importance for the future of religion has been neglected by the ‘ulama of this age”39. Following in Qutb’s footsteps, Farag rejects the traditional interpretation of the tenet of Jihad as primarily one of personal struggle for moral rectitude. He asserted that the real character of the duty of Jihad is clearly spelled out in the text of the Qur’an, “it is fighting, which means confrontation and blood.”40 In his view fighting is the only solution to the Muslims’ problems. Having defined Jihad as an act of violence, he elevated the tenet to the status of a pillar. It is a duty for every Muslim no less than the obligatory five pillars that Muslims are obligated to perform. That is to say he maintained that violent Jihad is the sixth pillar of Islam, forgotten by the believers. “As long as it is a pillar (Fard ‘Ayn) like praying and fasting (the holy month of Ramadan), one should not seek his parents’ permission before going out to undertake Jihad.”41 Farag claimed that the ultimate triumph of Islam has been prophesied, and all that remains is for Muslims to fulfil the prophecy. As present-day Muslims are living in nation states that are ruled by apostates, governing according to laws that are not based upon the Shari’a, it is imperative for Muslims to establish a Muslim rule. The mission of Islamic Jihad was to create a true Islamic state and society in Egypt as the first step in achieving the long-term goal of a single Muslim government under a true Islamic caliphate. Given the authoritarian and corrupt nature of present-day regimes, a true Islamic state could not be established through nonviolence but only through confrontation and blood42.
It is important to notice that under the subtitle “the near and far enemy”, Farag addressed the issue of priority in undertaking militant Jihad. While Arab public opinion and the mainstream Muslim Brotherhood have maintained that Jihad against the state of Israel should take precedence over toppling the existing sinful regimes (through armed revolution), Farag confronted this trend for the first time, stressing that it is more important to fight the nearby enemy, i.e. the enemy at home (the jahili regime) than the enemy that is far (Israel). Jihad’s first and foremost priority must be to replace the infidel rulers with a comprehensive Islamic system. If the militants began with the faraway enemy, the illegitimate Muslim ruler (the infidel) would turn the struggle to his advantage. In other words, Farag was anxious that the liberation of Jerusalem would strengthen and consolidate apostate Arab regimes:
“Muslim blood will be shed in order to realize this victory (over Israel). Now it must be asked whether this victory will benefit the interests of an Islamic state. Or will this victory benefit the interests of infidel rule? It will mean the strengthening of a state which rebels against the laws of God. These rulers will take advantage of the nationalist sentiments of these Muslims in order to realize their un-Islamic aims, even though these aims look Islamic at the surface. Fighting has to be done (only) under the Banner of Islam and under Islamic leadership”43.
That is to say that the first battlefield for Jihad is the extermination of these infidel rulers and to replace them by an Islamic Order and an Islamic state. As violence against those who support the apostate regime could very well kill Muslims, yet it is the responsibility of true Muslims to prove themselves. According to Farag’s interpretation, this gives Muslim radicals the freedom to fight and to kill nominal Muslims with the excuse that they should know better than to support the apostate regime. In this context, Farag used Hadith literature extensively in addition to the Qur’an as a source for his deliberations44.
It is obvious that many of the ideas put forward in al-Farida al-gha’iba were not new. Farag drew heavily upon the writings of two men in particular: the medieval Hanbali jurist Ibn Taymiyya and the prominent Sayyid Qutb. Ibn Taymiyya (1268-1328) lived during one of the most disruptive periods of Islamic history, which witnessed the Mongols’ conquest of the Abbasid Caliphate and the fall of Baghdad in 1258. His family was forced to flee to Damascus, and it may will be that his painful experience as refugee coloured his attitude toward the Mongols throughout his life and reflecting his emotional engagement with Jihad. There is no reason to doubt that a deeply felt injury can become like a cancer of the spirit, eating away at an individual or a community. Though the Mongols of Persia had embraced Sunni Islam by the late 13th century, their expansionist drive and violence continued. Hence, Ibn Taymiyya’s traumatic experience inspired his militant spirit and accounted for his readiness to issue radical legal opinions (fatwas) based on a rigorous, literalist interpretation of the Qur’an and Sunna. As a true Hanbali jurist, Ibn Taymiyya was anxious to impose God’s Will. In his view, a Sunni ruler becomes illegitimate if he does not apply the Shari’a or when he breaks major injunctions of the Faith. He equates between illegitimacy and apostasy. So, when a Sunni ruler neglects or transgresses the Shari’a, he becomes an infidel or rather an apostate. In this context, Ibn Taymiyya’s fatwa was that the Mongols, by implementing ‘man’s made law’ (the Yasa code) instead of the Shari’a, were in fact living in a state of jahiliyya. He challenged the Mongol’s understanding of Islam, pronouncing them un-Islamic. Consequently, Jihad against such apostates was not only allowed, but also obligatory45. It is, of course, important to acknowledge that declaring the Mongol leaders un-Islamic or apostate (according to Ibn Taymiyya’s fatwa) relieved the Mamluk Sultans and gave them a free hand to fight other Muslims, but it set a dangerous precedent that is at the heart of modern jihadists’ violence against the apostate rulers in the Muslim world46.. What is particularly noteworthy, is that he asserts in his fatwa that “Jihad is better than going on hajj and ‘umra” (pilgrimage and visiting the holy land), paving the way for Qutb to define Jihad as an individual and permanent obligation (fard ‘ayn), for Farag to maintain that Jihad is the forgotten sixth pillar of Islam, and for ‘Usamah bin Laden’s claim that Jihad is second in importance only to belief (Imaan)47.
As has already been observed, Jihad, for Qutb, was a permanent revolution against internal and external enemies who usurped God’s sovereignty (hakimiyya). It is probable that his ideas were as much the product of the brutality he experienced for years (1954-1965) in jail. Hence, “his teachings recast the world into black and white polarities. There were no shades of gray.”48 He painted and condemned all modern societies as anti-Islamic (jahili) and called for its destruction. As the creation of an Islamic government was a divine commandment, a vanguard of faithful believers must strive through violent Jihad to implement it. Precisely because his ideas are simple and simply expressed in fateful words, it is easy to see why his revolutionary ideology became popular and bore fruit across the Middle East and why his example has been repeatedly emulated49.
While Qutb produced an influential ideological manifesto for the contemporary Jihadist movement, Farag translated its meanings into operational terms. Farag was an activist who preached Jihad in local mosques, recruited militants, and plotted underground in coordinating the assassination of President Sadat. From 1979 through mid 1981 and under his charismatic leadership, the Jihad group managed to absorb many members and leaders of other dismantled secret revolutionary groups which had been established in the early 1970s such as al-Takfir wa-l Hijra and the Islamic Liberation (sometimes called The Military Academy group)50. The Jihad group’s well-educated members included, among others, familiar names like Lieutenant Colonel ‘Abboud al-Zumor, Lieutenant Khalid al-Islambouli (the assassin of President Sadat) and two physicians: Sayyid Imam al-Sharif, know as Dr. Fadl and Ayman al-Zawahiri. The bulk of the Jihadist movement accepted Farag’s call to Jihad against the near enemy and his definition of the enemy as being the local unbelieving regimes.
However, the radical project of the Jihadi groups, notably the Egyptian Islamic Jihad and al-Jama’a al-Islamiyya, inspired confrontation with the state through the 1970s, 1980s, and 1990s. The behaviour of these groups alarmed the state. The authorities realized the large size of these groups was growing even larger with the passage of time. Both groups were considered a danger to Egypt’s Arabo-Islamic and Christian-Coptic social fabrics. Not only did the state use its security forces to maintain its pressure on what remained of the country’s terrorist cells, but also began attempts to contain radicalism and to deradicalise these groups. This was not an easy task as deradicalisation attempts faced some difficulties and setbacks at times. But by the end of the 1990s, the victory of the state over the Jihadists was inevitable and the radical attempts to violently change society and politics had failed in Egypt.
1De Vries, Von Hent (ed.), Religion Beyond a concept (New York: Fordham University Press, 2007), 1
2(1) Cf., Ehteshami, Anoushiravan, “Islam as political force in international politics”, in: Lahoud, Nelly and Anthony Johns (eds.), Islam in World Politics (London and New York: Routledge, 2005), 29-53. For a precise, and analytically more useful, definition of Political Islam, see: Denoeux, Julian, “The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam”, Middle East Policy (June 2002), 61.
3Guazzone, Laura, “Islamism and Islamists in the Contemporary Arab World”, in: Laura Guazzone (ed.), The Islamist Dilemma. The Political Role of Islamist Movements in the Contemporary Arab World (Reading: Ithaca Press, 1995), 4. Cf. also, Esposito, John (ed.), Voices of Resurgent Islam (Oxford and New York: Oxford University press, 1983), 11.
4Cf. McDaniel, Timothy, “Responses to Modernization: Muslim Experience in a Comparative Perspective”, in: Hunter, Shireen, and Huma Malik (eds.), Modernization, Democracy, and Islam (Westport/Conn.: Greenwood Publishing Group, 2005), 35. However, the distinction between fundamentalist and traditional Islam is endemic to the scholarship on Islamism and often marks political versus quietist forms of Islamic activism. On the other hand, Islamism is a term with no universally agreed definition, but which is usually used to suggest that a particular group or movement is seeking to build political structures it deems Islamic. However, Islamic fundamentalism and Islamism have become synonyms in contemporary American usage. Cf.:http://www.reference.com/browse/wiki/Islamic_fundamentalists. (Accessed online, on July 24, 2009).
5Cf., Moaddel, Mansoor, Islamic Modernism, Nationalism, and Fundamentalism: Episode and Discourse (Chicago and London: The University of Chicago Press, 2005), 5; Moussalli, Ahmad, Moderate and Radical Islamic Fundamentalism: The Quest for Modernity, Legitimacy, and the Islamic State(Gainesville: University Press of Florida, 1999), 111-12.
6The Qur’an: 3 (Surat al-‘emran): 110.
7Cf., Voll, John, “Fundamentalism in the Sunni Arab World”, in: Martin Marty and Scott Appleby (eds.), Fundamentalism Observed. The Fundamental Project, vol. I (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1991), 347; Martin Marty and Scott Appleby,” Conclusion: An Interim Report”, in: Martin Marty and Scott Appleby (eds.), Fundamentalism Observed, 814; Fuller, Graham, The Future of political Islam (New York: Palgrave, 2003), xi; Cook, David, Understanding Jihad (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2005), 106-107.
8On the now disbanded Laskar Jihad group, see: Hasan, Noorhaidi, Laskar Jihad: Islam, Militancy and the Quest for Identity in Post-new Order Indonesia (Ithaca: Cornell South East Asia Program Publications, 2006); Davis, Michael, “Laskar Jihad and the Political Position of Conservative Islam in Indonesia”, Contemporary Southeast Asia, 24/1(2002), 12-32; Mulyadi, Sukidi, “Violence under the Banner of Religion: The Case of Laskar Jihad and Laskar Kristus”, Studia Islamika-Indonesian Journal for Islamic Studies, 10/2 (2003), 77-101. Cf. also : Hasan, Noorhaidi, “The Salafi Movement in Indonesia: Transnational Dynamics and Local Development”, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 27/1 (2007), 83-94.
9Arjomand, Said, “Unity and Diversity in Islamic Fundamentalism “, in: Martin Marty and Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms Comprehended. The Fundamentalism Project, vol. 5 (Chicago and London: the University of Chicago Press, 1995), 183; for more details on the Tablighi Jamaat movement, see, Mumtaz Ahmad, “Islamic Fundamentalism in South Asia: The Jamaat-I-Islami and the Tablighi Jamaat of South Asia”, in: Martin Marty and Scott Appleby (eds.), Fundamentalism Observed. The Fundamentalism Project, vol. 1: 510-24. Cf. also, Moussalli, Moderate and Radical Islamic Fundamentalism, 69.
10Cf., Halliday, Fred, Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in the Middle East (London, New York: I B Tauris, 1996), 110-12.
11Rabasa, Angel, et al. The Muslim World after 9/11 (Santa Monica/CA: Rand Corp, 2005), 14. On political Islam see, Kepel, Gilles, Jihad: The Trail of Political Islam (Cambridge/MA: Harvard University Press, 2002). On political Islam in Egypt see, Baker, Raymond, Islam without Fear: Egypt and the New Islamists (Cambridge/Mass., London: Harvard University Press, 2003), 165-211.
12Yusuf al-Qaradawi, Fatwa 23, in: Gräf, Bettina, Medien-Fatwas @Yusuf al-Qaradawi. Die Popularisierung des islamischen Rechts. [= Studien des Zentrum Moderner Orient, 27] (Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2010), Anhang III, 506. Cf. also, BBC News, ‘Al-Qaradawi Full Transcript’, Newsnight, 7 July 2004; Strawson, John, “Islam and the Politics of Terrorism: Aspects of the British Experience”, in: Gani, Miriam and Penelope Mathew (eds.), Fresh Perspectives on the ‘War on Terror’ (Canberra: The Australian National University Press, 2008), 14.
13Mustafa, Hala, “The Islamist Movements under Mubarak”, in: Laura Guazzone (ed.), The Islamist Dilemma. The Political Role of Islamist Movements in the Contemporary Arab World (Reading: Ithaca Press, 1995), 172.
14Sayyid Qutb developed a literary appreciation of the Qur’an and a methodology for its literal interpretation in his extensive commentary (tafsir), cf., Qutb, Sayyid, Fi Zilal al-Qur’an (In the Shade of the Qur’an). Rev. ed. (Beirut: Dar Al-Shuruq, 1973-1974), 6 vols. However, late in his life and while he was in jail, he synthesized his ideas and personal experience in his most influential work Ma’alim fi al-Tariq, which is considered a religious and political manifesto for what he believed to be a true Islamic system. See: Qutb, Sayyid, Ma’alim Fi al-Tariq (Beirut: Dar al-Shuruq, 1987); Eng. Trans. n.t., Milestones (New Delhi: Islamic Book Service, 2007). Cf. also, Dekmejian, Hrair, Islam in Revolution. Fundamentalism in the Arab World (Syracuse, New York: Syracuse University Press,1995), 90-92; Musallam, Adnan, From Secularism to Jihad: Sayyid Qutb and the Foundations of Radical Islamism (Westport/Conn.: Greenwood Publishing Group, 2005), 137-98.
15Cf., Sayyid Qutb, Islam: The True Religion, trans. Ravi Ahmad Fidai (Karachi, Pakistan: International Islamic Publishers, 1981), 25-26. On the other hand, in the introduction of his book Milestones, Qutb declared the following: “I have written ‘Milestones’ for this vanguard, which I consider to be a waiting reality about to be materialized”. See: Qutb, Milestones, 12. Cf. also, Sivan, Emmanuel, Radical Islam: Medieval Theology and Modern Politics (New Haven and London: Yale University Press, 1990), 21-25; Dekmejian, Islam in Revolution, 90-93.
16Qutb, Milestones, 20-21. For an explanation of the term Jahiliyya and Qutb’s use of it. See: Shepard, William, “Sayyid Qutb’s Doctrine of Jahiliyya”, International Journal of Middle East Studies, 35 /4 (2003), 521-45.
17Qutb, Milestones, 21, 22, 58, and 75.
18Cf. Qutb, Milestones, 53; Musallam, From Secularism to Jihad, 180. Mawdudi founded Jama’at-i- Islami in colonial India in 1941 as an Islamic revivalist party, later it became a powerful political force in Pakistan. He advocated an Islamic state based on the application of Shari’a. Cf., Mawdudi, Sayyid Abul A’la, The Islamic Movement: Dynamics of Values, Power, and Social Change, ed. Khurram Murad (London: The Islamic Foundation, 1984), 71-94; Sivan, Radical Islam, 22; Salim Ali al-Bahnasawi, Al-Hukm wa-Qadiyyat Takfir al-Muslim (Domination and the Issue of Identifying Someone as Unbeliever) (Kuwait, 1981), 48.
19Strawson,”Islam and the Politics of Terrorism”, 17. In the eyes of Muslim activists, Qutb died as martyr. His defiance, life in prison and death provided the younger militants with a model of martyrdom to emulate. He is the godfather to Muslim extremist movements around the globe, see: Esposito, John, Unholy War: Terror in the Name of Islam (Oxford: Oxford University Press, 2002), 56; Dekmejian, Islam in Revolution, 90.
20Cf., Musallam, From Secularism to Jihad. 172; Moussalli, Moderate and Radical Islamic Fundamentalism, 153; Irwin, Robert, “Is This the Man Who Inspired Bin Laden?” The Guardian, November 1st, 2001, at: www.guardian.co.uk; Zimmerman, John, “Sayyid Qutb’s Influence on the 11th September Attacks”, Terrorism and Political Violence, 16 /2 (Summer 2004), 238-40 and (endnotes) 250-52. It is further of interest to notice that, while Islamic fundamentalist movements are observable in the Middle East throughout its modern history, the most violent “global jihadism” did not emerge until the Soviet occupation of Afghanistan (1979-1989). At that time, Muslims from around the world came together to fight along side the Afghan mujahideed with the blessing and sponsorship of the USA. The after-effect of this experience was the development of a global infrastructure of jihad driven and eliminationist brand of militant Islam. Cf., Mamdani, Mahmood, Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror (New York: Pantheon Books, 2004), 130. On the post- cold war political topography of the Middle East, see Sandra Halperin in: http://www.theglobalsite.ac.uk/justpeace/110halperin.htm . (Accessed online, July 14, 2009).
21Hasan al-Hudaybi, the general guide of the Brotherhood, while in prison wrote a Book entitled “Missionaries, Not Judges” (Du’ah la Qudah), published in 1969, in which he criticized Milestones. Cf., Voll, “Fundamentalism in the Sunni Arab World”, 373. Furthermore, Al-Azhar condemned the book as heretical, cf., Kepel, Gilles, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and the Pharaoh (London: Saqi Books 1985), 101.
22On the composition of membership of these groups cf., Voll, Fundamentalism in the Sunni Arab World, 381-84. Dekmejian, Islam in Revolution, 92-93. Cf. also Salim Ali al-Bahnasawi, Al-Hukm wa-Qadiyyat Takfir al-Muslim, 4-42; Salim Ali al-Bahnasawi, Sayyid Qutb bayna al-‘atifah wa al-mawdu’iyyah (Alexandria, 1986), 91.
23On the rise of Islamic fundamentalism in Egypt, and Algeria, see: Moaddel, Islamic Modernism, Nationalism, and Fundamentalism, 197-220 and 265-91.
24It was the Shi’ites who first articulated the doctrine of ‘isma (infallibility) and applied it to their imams, see: Brown, Daniel, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 60-61.
25Rabasa, et al., The Muslim World after 9/11: 39.
26Cf., Khaled Abou El Fadl ,“The Place of Tolerance in Islam: On reading the Qur’an – and misreading it”, at: http://www.bostonreview.net/BR26.6/elfadl.html. (Accessed online, August 14, 2009).
27Khaled Abou El Fadl, “The Place of Tolerance in Islam”. Cf. Also: “Who Speaks for Islam?” paper prepared by Dialogues: Islamic World-US-The West, as background material for the February 10-11, 2006 conference in Kuala Lumpur, at: http://islamuswest.org/pdfs_Islam_and_the_West/whospeaksforislam.pdf. (Accessed online, August 15, 2009).
28Cf., Fazlur Rahman, Islam & Modernity. Transformation of an Intellectual Tradition (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1982), 101- 104; Gaffney, Patrick, “The Changing Voices of Islam: Professional Preachers in Contemporary Egypt”, The Muslim World, 81 (1991), 29; Zeghal, Malika, “Religion and Politics in Egypt: The Ulama of al-Azhar, Radical Islam, and the State (1952-94)”, The International Journal of Middle East Studies, 31, no.3 (1999), 371-91; Fahmi, Georges, “The Islamic Religious Elite in the Mediterranean: Preacher for Dialogue or vanguard for the Clash. The Egyptian Case”, at: www.humanrights-observatory.net/…/GEORGE%20FAHMI.pdf. (Accessed online, on August 18, 2009).
29“Who Speaks for Islam?” 6-7; Khaled Abou El Fadl, “The Place of Tolerance in Islam” Cf. also, Moustafa, Tamir, “Conflict and Cooperation between the State and Religious Institutions in Contemporary Egypt”, The International Journal of Middle East Studies, 32 (2000), 3-22; Starrett, Gregory, Putting Islam to Work: Education, Politics and Religious Transformation in Egypt (Berkeley: University of California Press, 1998), 89; Esposito, John, The Islamic Threat: Myth or Reality? (Oxford and New York: Oxford University Press, 1992), 100. On religiopolitical activism and the scholars of religion (‘ulama), see: Zaman, Muhammad, The Ulama in Contemporary Islam. Custodians of Change (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2002), 144-80. For a comprehensive history of the office of the State mufti and Dar al-Ifta’ see, Skovgaard-Petersen, Jakob, Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and fatwas of the Dar al-Ifta’ (Leiden and New York: Brill, 1997).
30Abdo, Geneive, No God but God: Egypt and the Triumph of Islam (Oxford: Oxford University Press, 2002), 50. Cf. also, Moustafa, Tamir, “Conflict and Cooperation”, 5; Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, 53.
31On the affinities between some Azhari ‘ulama and the Muslim Brotherhood, see: Mitchell, Richard, The Society of the Muslim Brothers (Oxford: Oxford University Press, 1969), 211-12. Cf. also, Barraclough, Steven, “Al-Azhar: Between the Government and the Islamists”, Middle East Journal, 52/2 (1998), 236-49.
32Zeghal, Malika, “Religion and Politics in Egypt”, 372, 381-85. Cf. also, Bachar, Shmuel et al., “Establishment Ulama and Radicalism in Egypt, Saudi Arabia, and Jordan”, Hudson Institute, at: http://www.futureofmuslimworld.com/docLib/20061226_UlamaandRadicalismfinal.pdf (Accessed online, on August 19, 2009).
33Abduh, Muhammad, The Theology of Unity, Eng. trans. Musa’ad, Ishaq and Kenneth Cragg (London: George Allen and Unwin, 1966), 30-31 and 156; Al-Liwa’ al-Islami, September 11, 2003. Cf. also, Bachar ,Shmuel et al., “Establishment Ulama and Radicalism in Egypt, Saudi Arabia, and Jordan”, Hudson Institute, at: http://www.futureofmuslimworld.com/docLib/20061226_UlamaandRadicalismfinal.pdf
34Esposito, Unholy War, 50. Cf. also, “Who Speaks for Islam?”, 9, 18.
35Cf. Gerges, Fawaz, The Far Enemy: Why Jihad went Global (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2005), 1-15; Ackerman, Gary and Jeremy Tamsett (eds.), Jihadists and Weapons of Mass Destruction: A Growing Threat (Boca Raton, FL: CRC Press, 2009), xviii. On the common characteristics of these groups in Egypt see: Mustafa, Hala, “The Islamist Movements under Mubarak”, 172-76.
36Cf., Rugh, Andrea, “Reshaping Personal Relations in Egypt”, in: Marty, Martin and Scott Appleby (eds.), Fundamentalisms and Society. The Fundamentalism Project, vol. 2 (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1993), 153; Ayoubi, Nazih, “The Politics of Militant Islamic Movements in the Middle East”, Journal of International Affairs 36, no. 2 (Fall/Winter 1982-83), 271-83.
37For more details on al-Jama’a al-Islamiyya, see CDI Terrorism Project at: http://www.cdi.org/terrorism/algamaa-pr.cfm. (Accessed online, on August 25, 2009). Cf., Kepel, Gilles, The War for Muslim Minds. Islam and the West (Cambridge, Mass., and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004), 82; Musallam, From Secularism to Jihad, 194-96.
38Bar, Shmuel, Warrant for Terror: Fatwas of Radical Islam and the Duty of Jihad (New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2006), xiii. On how the blind Sheikh acquired a U.S.Visa in 1990, cf. Ensalaco, Mark, Middle Eastern Terrorism: From Black September to September 11 (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008), 131.
39Farag, Muhammad Abdel-Salam, Al-Jihad: al-Farida al-Gha’iba (Beirut, n.d.), p.2; Eng. trans. Jansen, Johannes, in: Jansen, The Neglected Duty: The Creed of Saddat’s Assassins and Islamic Resurgence in the Middle East (New York: Macmillan, 1986). Cf. also, Sivan, Radical Islam, 127.
40Farag, Al-Jihad: al-Farida al-Gha’iba, 13.
41Farag, Al-Jihad: al-Farida al-Gha’iba, 14. On the other five pillars of Islam, see: Musallam, From Secularism to Jihad, 186.
42Cf., Cook, David, Understanding Jihad , 107-10; Esposito, Unholy War, 62-64, and 90.
43Farag, Al-Jihad: al-Farida al-Gha’iba, 11; Cook, Understanding Jihad, 108. Cf. also, Kepel, The War for Muslim Minds, 81.
44Farag, Al-Jihad: al-Farida al-Gha’iba, 8; Cook, Understanding Jihad, 107-109.
45Cf., Ibn Taymiyya, Taqi al-Din Ahmad, Majmu’ al-Fatawa (Cairo, n.d.), XXVIII: 410-67, 501-8, and 589-90; Cook, Understanding Jihad, 63-66; Sivan, Radical Islam, 94-100; Esposito, Unholy War, 45-46; Jansen, Johannes, “Ibn Taymiyyah and the Thirteenth Century: A Formative Period of Modern Muslim Radicalism”, Quadreni di Studi Arabi, 5-6 (1987-88), 391-96; Morabia, Alfred, “Ibn Taymiyya: Dernier grand theoretician du Ğihad medieval”, Bulletin d’études orientales, 30 (1978), 85-100.
46McGregor, Andrew, “Jihad and the rifle Alone: Abdullah ‘Azzam and the Islamist Revolution“, The Journal of Conflict Studies, 23/ 2 (Fall 2003), 96.
47Ibn Taymiyya, Majmu’ al-Fatawa, XXXV: 160. He based his fatwa on a rigorous and over interpretation of certain verses in the Qur’an, cf., The Qur’an: 9 (Surat al-tauba): 19-20.
48Esposito, Unholy War, 60.
49Cf. Cook, Understanding Jihad, 102-7; Esposito, Unholy War, 56-62.
50The Society of Muslims’ group, known as al-Takfir wa-l Hijra followed an extreme tradition that rejected all of society as unbelieving, advocated withdrawal from it and the formation of a new believing society. This group was involved in the kidnapping and killing of Sheikh Husayn al-Dhahabi, Minister of Endowments and Religious Affairs, in 1977. Shukri Mustafa, the leader of the group, was executed among others in March 1978. On the other hand, the Islamic Liberation Group (sometimes called The Military Academy Group) was formed by Salih Siriyya, a Palestinian living in Egypt. The group worked for the creation of a strict Islamic society and an Islamic government. Siriyya and his followers tried to instigate a coup d’état in Egypt. His failed attempt to take over the Technical Military Academy in 1974 led to his execution. Cf., Voll, John,“Fundamentalism in the Sunni Arab World”, 382-83; Sivan, Radical Islam, 19-21 and 112; Dekmejian, Islam in Revolution, 94-96; Ayubi, Nazih, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World (London and New York: Routledge, 1991), 73; Kepel, Gilles, The Roots of Radical Islam, Eng. trans. Jon Rothschild (London: Saqi Books, 2005), 70-104.
Dec 31 2013
(Deutsch) Kai Merten, Das äthiopisch-orthodoxe Christentum. Ein Versuch zu verstehen.
Désolé, cet article est seulement disponible en Deutsch.
Oct 05 2013
(Deutsch) Alexander Flores, Säkularismus und Islam in Ägypten. Die Debatte der 1980er Jahre
Désolé, cet article est seulement disponible en Deutsch.
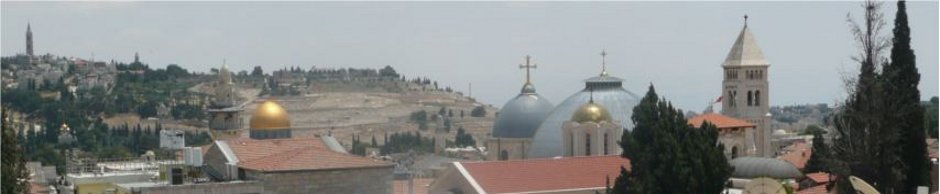
Recent Comments