Harald Suermann, Die Gründungsgeschichte der Maronitischen Kirche, Orientalia Biblica et Christiana 10, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1998, 343 p., avec bibliographie, index et carte.
Compte rendu était déjà publié en Syria, 81, 2004, 331-332.
L’ouvrage, issu d’une Habilitationschrift présentée devant l’université de Bonn, étudie l’histoire de la naissance de l’Eglise maronite, depuis les premières mentions d’un saint Maron et d’un monastère de Mar Maron, jusqu’à la mise en place d’une hiérarchie indépendante et la constitution d’une Eglise séparée, avec l’installation d’un patriarcat propre.
Le livre commence par un exposé historiographique, qui passe en revue les ouvrages consacrés à cette question, non seulement les sources anciennes mais aussi la littérature scientifique moderne. De fait, il y a en quelque sorte continuité des unes à l’autre, à travers Ibn al-Qula’i, un franciscain maronite, formé à Rome et mort en 1515, dont toute l’œuvre visait à conforter le lien de son Eglise avec Rome et à la laver du soupçon d’hérésie, le patriarche Duwaihi (1630-1704) qui a été le premier à tenter d’écrire une histoire systématique des maronites et Joseph Assemani, bibliothécaire à la Vaticane et auteur de la magistrale Biblioteca Orientalis. H. Suermann montre bien comment la recherche, y compris très récente, a souvent eu du mal à se dégager de considérations apologétiques et d’un souci de démontrer « la perpétuelle orthodoxie des maronites ». De fait, le sujet est brûlant, et c’est un des mérites de l’auteur de souhaiter l’aborder en toute rigueur.
L’auteur montre comment le groupe appelé « maronite » a longtemps été surtout un groupe de pression et d’influence, organisé autour du monastère de Mar Maron. Les traditions relatives à sa fondation sont examinées en premier, l’une remontant à Eutychès (Sa‛íd ibn Baṭríq), patriarche d’Alexandrie (877-940) suivi par Mas‛ūdī, qui la place sous le règne de Maurice (582-602), l’autre au traditionniste musulman Abūl-Fidā, qui l’attribue à Marcien (450-457). C’est cette dernière tradition qui est la plus fiable pour H. Suermann. D’après lui, ce monastère aurait été fondé à la suite du concile de Chalcédoine, peut-être par l’empereur Marcien, pour conforter le parti chalcédonien et renforcer le monachisme pro-chalcédonien face aux nombreux moines ayant pris parti pour la définition « monophysite ». Si l’auteur montre qu’on ne peut le localiser avec certitude, il circonscrit cependant la région où il était implanté en Syrie Seconde, non loin de l’Oronte, dans la région de Hama, Apamée et Shaïzar.
Le monastère apparaît dans l’histoire pour la première fois à l’occasion du schisme acacien, quand l’évêque Acace avait été sur le point de rétablir l’unité de l’Église d’Orient contre Rome. Mais les moines de Syrie Seconde et de Palestine se rebellèrent, firent appel au pape Hormisdas et exigèrent du nouvel empereur, Justin, la reconnaissance de Chalcédoine. Le monastère de Mar Maron semble alors avoir été à la pointe de l’activité anti-acacienne, mais de façon assez informelle.
Il n’en alla pas de même, quelques années plus tard, lorsque l’empereur Justinien eut permis une véritable restauration du parti monophysite et tenta en 532 une conciliation entre chalcédoniens et sévériens. Aux côtés du patriarche d’Antioche Ephrem, un chalcédonien convaincu, le monastère de Mar Maron est à la tête d’une véritable confédération de monastères, qu’il contrôle par l’intermédiaire d’un exarque et avec laquelle il engage un combat résolu pour une reconnaissance claire de Chalcédoine par le pouvoir.
Si le contexte de l’apparition de la doctrine monothélite, affirmant l’unique volonté du Christ, est mal connu, le monastère de Mar Maron en a été un partisan convaincu, dès le règne de l’empereur Héraclius (610-641) qui souhaitait sur cette base rétablir l’unité de l’Église entre monophysites et chalcédoniens. Ce souhait s’est révélé vain mais la tentative divisa l’Église chalcédonienne elle-même et, dès lors, la confédération dirigée par Mar Maron a été la représentante d’un des deux partis qui se la disputaient : elle formait donc une véritable école de pensée théologique et il semble y avoir eu une sorte d’équivalence entre les notions de « monothélite » et de « maronite ». De plus, la tradition maronite ultérieure s’est approprié toute une série de documents du parti monothélite.
Les deux partis rompirent clairement lors du concile de 680/681 qui trancha en faveur de la définition des deux volontés (« diothélisme »). Cette définition théologique fut imposée sur le territoire de l’empire byzantin, mais la Syrie, entre temps, avait été conquise par les Arabes et les deux partis continuèrent à s’y disputer. L’autorité politique musulmane dut même parfois intervenir dans le conflit pour l’attribution des églises entre les deux partis, comme à Alep, Édesse ou Mabboug, mais le conflit se situait encore à l’intérieur de l’Église chalcédonienne. La rupture en deux Églises se produisit sous le patriarche Bar Qanbara, qui chercha à imposer une profession de foi diothélite aux moines de Mar Maron (vers 745). Ceux-ci, selon la tradition, élirent un patriarche propre, consommant la division de l’Église chalcédonienne : ce serait le véritable acte de naissance de l’Église maronite. Mais, s’opposant à l’historiographie la plus récente, H. Suermann montre bien que la tradition relative à Jean Maron, qui aurait été le premier patriarche, ne s’appuie sur aucune document ancien et relève sans doute de la légende.
Les siècles étudiés ici sont donc cruciaux pour l’histoire maronite. D’un monastère, le mouvement évolue vers un parti théologique puis vers une Église autonome. Le sujet est complexe, et les sources bien lacunaires ou postérieures aux événements, ce qui rend l’analyse des événements souvent confuse. Beaucoup des hypothèses avancées doivent donc rester des hypothèses et il est souvent difficile de trancher. L’intérêt principal de l’ouvrage réside sans doute plus dans les remises en cause qu’il opère dans une tradition souvent trop apologétique. A ce titre, son importance est cruciale dans la réflexion sur l’histoire et l’identité de l’Eglise maronite et on sera très reconnaissant à H. Suermann de nous offrir ici un ouvrage d’un véritable esprit critique. On se rejouira donc de savoir que l’ouvrage est en cours de publication en version française, ce qui est essentiel pour sa diffusion au Liban et dans le monde maronite.
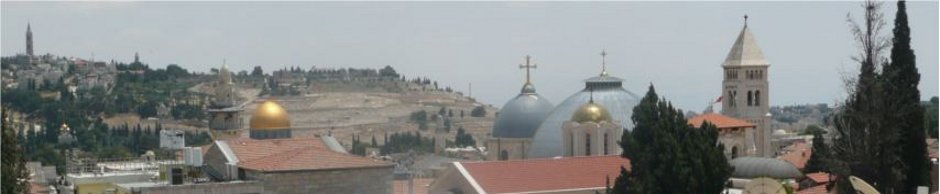
Recent Comments